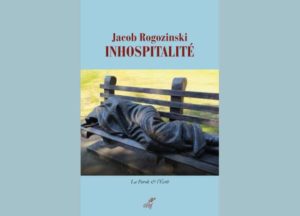Titre
InhospitalitéAuteur
Jacob RogozinskiType
livreEditeur
Paris : Éd. du Cerf, 2024Collection
La Parole et l’ÉcritNombre de pages
139 pages.Prix
18€Date de publication
18 décembre 2024Inhospitalité.
Pourquoi les migrants sont-ils rejetés, de plus en plus fortement ? C’est la question que Jacob Rogozinski1 tente de traiter en s’interrogeant sur la notion d’inhospitalité (“J’étais un étranger et vous ne m’avez pas accueilli”2) qui serait à l’œuvre dans ce rejet, prenant ainsi le contre-pied de l’approche classique symétrique des fondements de l’hospitalité.3 L’auteur est un philosophe d’origine juive (le livre est dédié à ses parents qui étaient immigrés en France), ayant publié autour de thèmes tels que la haine, le don, l’éthique…
Le premier chapitre expose la vision de plusieurs philosophes : Derrida avec son hospitalité inconditionnelle, c’est-à-dire l’accueil sans condition, position radicale menant vite à une impasse ; Kant, qui adopte une approche juridique et politique et non morale en défendant une hospitalité cosmopolitique visant le partage de la terre entre les humains : la vision est celle d’une société des citoyens du monde.
Mais l’inhospitalité semble très liée à la notion récente (développée au XIXème siècle) de Nation, d’où le besoin de déconstruire la nation, objet du second chapitre. Elle s’origine dans la figuration de la communauté comme un Corps-Un, d’où le rejet de l’ennemi étranger, qui s’est exprimé dans le basculement de la Révolution française, dont le projet était initialement universaliste, lors de la Terreur en 1793 lorsque les ennemis de la Révolution sont assimilés aux étrangers à combattre.
Est-ce suffisant et n’y a-t-il pas des racines plus profondes ? Il faut alors se tourner vers la psychanalyse : on y trouve l’angoisse archaïque de morcellement, la crainte d’intrusion d’un mauvais objet, dans une clôture du corps par la frontière de la peau, d’où le parallèle avec la pathologie sociale de la xénophobie. La phénoménologie nous emmène plus loin en distinguant le corps et la chair, suggérant un reste de non-chair qui peut susciter de l’angoisse et de la haine, ce qui met en cause l’unité même de la personne et entraine des mécanismes de rejet internes à son propre corps. Le parallèle avec les mouvements totalitaires et xénophobes est alors naturel, posant la question de la démocratie dont l’auteur nous dit qu’elle dépend en grande partie de l’hospitalité envers les étrangers. Il s’agit de les intégrer sans chercher à effacer leur différence…
La conclusion résume bien le propos d’ensemble du livre en évoquant cette difficile hospitalité. Elle évoque l’enrichissement de cet élargissement du monde, vantant la créolisation, selon l’expression d’Edouard Glissant, dans une vision de citoyenneté transnationale
Cet ouvrage est à la fois stimulant et d’un abord difficile pour les non-philosophes (ce qui est mon cas). Stimulant, car il cherche bien les ressorts de cette inhospitalité jusque dans les racines de la personne humaine. Les considérations philosophiques et psychanalytiques de l’ouvrage sont compréhensibles et éclairantes mais font référence à des débats concernant davantage les spécialistes que le grand public. Surtout on a l’impression que le propos de Jacob Rogozinski, stimulant répétons le, ne traite que partiellement du rejet des migrants tout en ouvrant sur la question plus large des relations interpersonnelles et des limites de l’accueil de l’autre, ce qui pourrait tout aussi bien s’appliquer au couple et à la famille… On reste ainsi sur sa faim pour les débats sur les notions de frontière, démocratie, intégration, et pour l’absence des éclairages potentiels de la sociologie, mais il est vrai que ce n’est pas le propos.
Xavier Godard
Ancien administrateur de CDM
1 Professeur à la faculté de philosophie de Strasbourg, Jacob Rogozinski est l’auteur de plusieurs livres (sur Kant, Artaud, Derrida, la chasse aux sorcières, le djihadisme…) et récemment de Moïse l’insurgé aux éd. du Cerf.
2 Cf. la description prophétique du jugement dernier dans l’évangile selon st Matthieu, ch.25, 43
3 Parmi de multiples références, on peut citer l’ouvrage : L’hospitalité divine : l’autre dans le dialogue des théologies chrétienne et musulmane/Nayla Tabbara et Fadi Daou.-Munster, Allemagne : LIT Verlag, 2013.- (Colloquium salutis).
Notes de la rédaction
Voir aussi : La grâce de l’hospitalité / Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d’Hippone… [et al.] ; Le courage de l’hospitalité : dossier de la Revue Esprit, n°446 / Olivier Mongin, dir. de la publication ; A. Garapon et J.-L. Schlegel, dir.- Revue Esprit, juillet-août 2018 ; La fin de l’hospitalité : l’Europe terre d’asile ? / Fabienne Brugère, Guillaume Le Blanc.-Flammarion, 2017, rééd. mai 2018.- (Champs. Essais)
Et toutes les autres recensions sur Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. Recensions du site de Chrétiens de la Méditerranée auxquelles il faut ajouter les titres suivants :
En transit : les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, 1880-1914. (éd. 2022)
Heureux ceux qui accueillent ; moines de Tibhirine : vivre l’hospitalité (éd. 2023)
Voir aussi les Rencontres méditerranéennes qui se sont déroulées à Marseille du 6 au 8 avril 2024 sur Les migrants en Méditerranée.