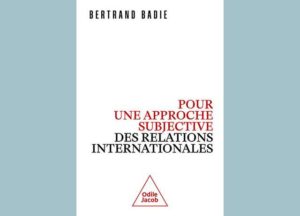Titre
Pour une approche subjective des relations internationalesAuteur
Bertrand BadieType
livreEditeur
Paris : Odile Jacob, 2023Nombre de pages
139 p.Prix
16,90 €Date de publication
1 janvier 2025Pour une approche subjective des relations internationales.
Dans ce petit livre fondamental, Bertrand Badie1 nous fait profiter de ses compétences politiques, philosophiques et historiques.
Par une introduction magistrale, il annonce son propos : montrer que les relations internationales ne sont plus seulement une science de la puissance entre nations mais une sociologie des interactions “serrées et délicates”, entre huit milliards d’individus, dont font partie l’identité, les intérêts, le sens mais aussi les signes échangés. Il réalise cette démonstration en quatre parties.
La première consiste à montrer comment il importe de s’émanciper des vieilles pesanteurs de la géopolitique. Encore faut-il la définir, ce que l’auteur fait en remontant à ses origines où elle fixait l’humain sur un territoire. Il y avait alors continuité entre le militaire et le politique. Les princes, à l’époque, rassemblaient tout un peuple en une nation. Et les cartes montraient les débats entre les puissances. Cette notion est-elle datée ? Pas tant que cela car elle rassure en faisant entrevoir les grandes entités géographiques qui pèsent encore. Pourtant si la géopolitique perd sa prétention épistémologique, elle garde encore une vertu descriptive du jeu des États. Mais il faut, aujourd’hui, ajouter la subjectivité et la complexité de chaque acteur que la géopolitique ne voyait pas.
Dans une seconde partie, Bertrand Badie invite ce nouveau regard sur les relations internationales à ne pas oublier qu’il doit tenir compte du réel et du passé institutionnel qui continuent à faire rêver les nostalgiques de la realpolitik. Car le système international moderne a été inventé par l’Europe. Mais il reste aujourd’hui plus bricolé que construit, soumis aux conjonctures et aux aubaines. A ce système, quelque peu officiel, s’ajoute l’irruption des sociétés humaines dans le jeu international par l’intermédiaire des sentiments, comme l’hostilité du Sud face à l’Occident.
La troisième partie développe l’environnement des nouveaux acteurs du système sous forme de questions : comment identifier les acteurs vraiment pertinents sur la scène internationale ? Comment saisir le sens de leurs initiatives ? Comment chacun se perçoit-il dans le contexte mondial ? Et surtout comment, finalement, ces acteurs sont-ils capables de coordonner leurs actions, “de fusionner leurs horizons”, ce qui permettrait de construire une paix moderne ? A ces questions, on comprend l’imbroglio des conflits modernes. Avec qui négocier dans des situations où sont engagés des chefs mafieux, des groupes terroristes, des patrons de multinationales comme Elon Musk ? Une nouvelle approche sociologique des relations internationales s’interroge sur la capacité de saisir l’Autre au-delà des préjugés, sur ses propres clés de compréhension, comme sur sa lecture du contexte international. Il faut une “empathie cognitive” pour avancer. C’est tout l’art du dialogue.
Enfin, la quatrième partie invite à repenser l’agenda international. Il doit prendre en compte la fragilité des nouvelles relations internationales, dépendante de quatre tensions majeures : la première, est celle de la reconnaissance de l’Autre, souvent abîmée par des humiliations qui taxent l’adversaire d’empire malade, ou de sous-développé. La deuxième, consiste dans la diversité des perceptions des situations conflictuelles, par exemple quand on ramène le conflit sahélien à un débat sur le terrorisme, alors que c’est bien autre chose. La troisième, concerne l’interprétation des codes et du langage diplomatiques utilisés : parler trop vite de la communauté internationale est une manière de nier les conflits et les héritages douloureux. La dernière, touche enfin le sens imprévisible des crises de la puissance qui s’exprime de multiples manières : les armées, les échanges commerciaux ou la force psychologique. Dans l’action diplomatique il faut savoir de quelle force on parle.
En conclusion, Bertrand Badie rappelle qu’il importe désormais de savoir écouter les paramètres subjectifs des relations internationales qui ont été trop souvent marginalisés.
Pierre de Charentenay
Notes de la rédaction
1 Professeur émérite des Universités (Sciences Po Paris).
Voir les autres livres de Bertrand Badie, recensés sur le site de CDM :
L’art de la paix : neuf vertus à honorer et autant de conditions à établir/ Bertrand Badie Paris : Flammarion, 2024
Le monde ne sera plus comme avant/sous la direction de Bertrand Badie et Dominique Vidal.- [Paris] : LLL Les Liens qui libèrent, 2022.-(Le monde d’après)
Les Puissances mondialisées : repenser la sécurité internationale /Bertrand Badie.- Paris : Odile Jacob, 2021
Quand le Sud réinvente le monde : essai sur la puissance de la faiblesse/Bertrand Badie.-Paris : La Découverte, 2018.- (Cahiers libres)
Nous ne sommes plus seuls au monde : un autre regard sur l’ « ordre international » /Bertrand Badie.- Paris : La Découverte, 2016.- (Cahiers libres)