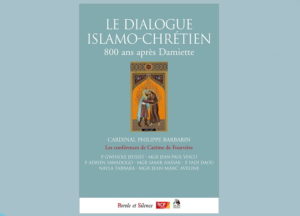Titre
Le dialogue islamo-chrétien, 800 ans après DamietteSous titre
Conférences de Carême 2019 à Notre Dame de FourvièreAuteur
P. Gwenolé Jeusset, Mgr Jean-Paul Vesco, P. Adrien Sawadogo [et al.] ; préface du Cardinal Philippe BarbarinType
livreEditeur
Paris : Parole et Silence, 2019Nombre de pages
158 p.Prix
13 €Date de publication
19 septembre 2019Le dialogue islamo-chrétien, 800 ans après Damiette
Lors de la cinquième croisade, François d’Assise s’est aventuré en terre musulmane pour rendre visite au sultan Malik al-Kâmil. Cette rencontre dont, au demeurant, nous savons peu de choses, a nourri depuis huit siècles de multiples interprétations, légitimant au cours des âges les positions théologiques des missionnaires franciscains comme celles du Magistère de l’Église. Nous devons à l’historien John Tolan d’avoir établi l’histoire de ces lectures dans Le saint chez le sultan.[1] Il concluait en montrant l’appropriation ultime de cette rencontre par le pape Benoît XVI qui y voyait le paradigme du dialogue islamo-chrétien.
Dans un contexte international sous tension, marqué par la recrudescence d’actes de violence entre des chrétiens et des musulmans, mais aussi par la suspicion catholique envers le dialogue tel qu’il est promu depuis le Concile[2], le huitième centenaire de la rencontre de Damiette est l’occasion d’écrire une page nouvelle de ces lectures. L’idée de ces conférences de carême de Fourvière était d’exposer quelques rencontres personnelles entre chrétiens et musulmans, de souligner combien l’esprit de Damiette, au-delà des interprétations historiques, trouve aujourd’hui des expressions diverses chez ces témoins musulmans et chrétiens qui se rencontrent et se parlent pour mieux s’accueillir, se connaître, se reconnaître, chacun dans sa différence.
Un des points de nouveauté que le Cardinal Barbarin souligne dans sa préface est celui de l’admiration nécessaire envers l’autre. La déclaration Nostra Aetate avait posé les jalons de l’estime de l’autre, de la fraternité universelle ; le concile avait rappelé dans la ligne des Pères, l’existence des semences du Verbe et la présence des rayons de vérité. Cette ouverture à l’autre, au-delà de l’estime – ce qui est bien plus profond que la simple tolérance -, peut faire naître « une secrète admiration de l’autre (…) un aiguillon spirituel, un appel à sortir de sa propre médiocrité » (p. 14). Si d’admiration il est question dans ces conférences, elle porte avant tout sur la force, le courage, la fécondité de ces témoins musulmans et chrétiens, investis ensemble pour servir Dieu dans le prochain, au-delà des appartenances religieuses, des conflits idéologiques et des chocs des théologies.
Dans la première conférence, le frère Gwenolé Jeusset[3] revient sur la fameuse rencontre de Damiette. Il en donne une lecture personnelle et dessine les vertus pour promouvoir une rencontre réussie. Pour le franciscain, l’humilité et la bonne humeur vont de pair : elles permettent de dépasser les conflits entre deux mondes, deux systèmes, deux différences dogmatiques qui finissent par faire oublier la commune réalité, celle de l’humanité. Pour lui, l’esprit de Damiette est vivant en cette fin de vingtième siècle dans les rencontres d’Assise de 1986. Il est présent à chaque fois que l’on visite l’autre côté de la mer, où l’on répond à l’invitation même de Dieu.
Mgr Jean-Paul Vesco revient sur la béatification de Mgr Pierre Claverie et de ses 18 compagnons religieux et religieuses martyrs[4]. Que la béatification puisse avoir lieu à Oran, en Algérie, n’était pas gagné d’avance. Les cicatrices de la guerre civile sur fond de blessures dues à la décolonisation étaient encore vives. Comment célébrer 19 religieux et religieuses martyrs quand près de 200 000 algériens musulmans ont été assassinés ? Comment honorer ces religieux, en majorité français, en Algérie ? Comment ne pas aller à l’encontre de la charte de la réconciliation nationale du 27 février 2006 qui invite à aller de l’avant et à ne plus se retourner sur les évènements du passé ? Comment envisager de célébrer des « martyrs en haine de la foi », selon l’expression consignée, mais fort peu appropriée ?
Mgr Vesco expose les difficultés, nombreuses, mais aussi sa conviction : pour être juste, la béatification devait célébrer la fraternité et permettre d’être signe de réconciliation fraternelle pour tous, elle devait être le moment de proximité avec l’autre, celle d’une communion de visage, du partage d’un sourire qui dit dans le concret et la simplicité de la relation l’amitié pour l’autre, sans faux semblant. C’est à cela que l’Eglise d’Algérie avec les musulmans a travaillé et est parvenue, le 8 décembre 2018. A ceux qui voient dans de tels propos naïveté ou candeur, Mgr Vesco répond par les échanges du pape François et d’Ahmad al-Tayyeb, le grand Imam d’al-Azhar, qui ont conduit au document sur la fraternité humaine[5] : il est « d’abord le fruit de la fraternité entre ces deux hommes » (p. 58). Il souligne que le dialogue n’est possible que dans le respect de la foi de l’autre, avec la certitude que cette foi ouvre au salut, « sinon cet accord serait un péché contre l’Esprit et chacun porterait le poids de la perdition de l’autre pour n’avoir pas essayé de l’amener sur le chemin de la conversion » (p. 58-59). Mgr Vesco conclut par quelques remarques sur l’évangélisation : elle se doit d’être l’imitation de Jésus-Christ en tant qu’il va de rencontres en rencontres.
Le Père Adrien Sawadogo est burkinabé et membre de la Société des Missionnaires d’Afrique depuis 2004. Il dirige le Centre « Foi et Rencontre » et l’Institut de Formation Islamo-chrétienne à Bamako. Constatant une remise en cause de la pluralité religieuse, le Centre et l’Institut restent des marqueurs d’espérance où les valeurs traditionnelles de la culture africaine attestent du sacré de la liberté religieuse, du respect de la vie et de la sauvegarde de la vie.
Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de Damas, propose le Bon Samaritain comme guide du dialogue islamo-chrétien, de la fraternité humaine à laquelle « nous sommes condamnés » (p. 84).
Le Père Fadi Daou et Nayla Tabbara rendent compte de l’expérience de la fondation Adyan au Liban en 2006[6]. Le père maronite distingue trois verbes clefs pour présenter la mission chrétienne aujourd’hui : reconnaître, préserver, faire progresser (p. 105). Il rappelle que le dialogue n’est pas une fin en soi ; il est un moyen qui permet d’aller au-delà des peurs ou mémoires blessées et des préjugés ; il implique d’aller au-delà du dialogue, et donc au-delà de la religion, là où est Dieu lui-même. Quant à Nayla Tabbara, elle centre sa réflexion sur l’expression de « solidarité spirituelle » qui signifie que « chacun, musulman et chrétien, porte devant Dieu les soucis de son frère, ses souffrances, ses espérances et ses souhaits » (p. 120).
Dans la synthèse finale, Monseigneur Aveline concluait à la nécessité de penser davantage le rôle de l’Esprit Saint dans la mission de l’Église (p. 146). Il s’agit de promouvoir une pneumatologie sans qu’elle soit au détriment de la christologie. Il s’agit aussi dans la manière d’appréhender le rapport entre dialogue et annonce, d’envisager l’Église dans sa réalité intérieure et comme ‘ministère’ « c’est-à-dire [de] service, car sa mission est d’être au service de la relation de Dieu avec le monde » (p. 152).
Fr. Emmanuel Pisani
[1] John Tolan.- Le saint chez le sultan : La rencontre de François d’Assise et de l’islam. Huit siècles d’interprétations.- Paris : Seuil, 2007. Regarder aussi sur KTO l’ouverture des célébrations en mémoire de cette rencontre à Damiette (Égypte), 800 ans après (durée : 19 mn).
[2] À lire : L’Eglise et les religions non chrétiennes : Déclaration Nostra Aetate, promulguée par le Concile Vatican 2, le 28/10/1965.
[3] À lire de Gwenolé Jeusset son livre : Assise ou Lépante ? : le défi de la rencontre.- éd. Franciscaines, 2014, et son intervention lors du rassemblement des religions et des cultures pour la paix, à Assise, le 19/09/2016, publiée par la Communauté Sant’Egidio : Aller sur la rive de l’autre : Saint François et le sultan
[4] À lire : Regards sur la béatification de Mgr Pierre Claverie et ses 18 compagnons et nos recensions des livres suivants : Pierre Claverie : la fécondité d’une vie donnée / sous la dir. de J.-J. Pérennès.- Cerf, 2018
C’était une longue fidélité à l’Algérie : béatification de Christian Chessel, Jean Chevillard, Charles Deckers, Alain Dieulangard, pères blancs-missionnaires d’Afrique, Tizi Ouzou, 27 décembre 1994 /Armand Duval, Médiaspaul, 2018. L’actualité de l’œuvre de Pierre Claverie, vingt ans après sa mort /sous la dir. de Bernard Janicot.- Cerf, 2017. Tibhirine, l’héritage.- Bayard, 2016. Petit traité de la rencontre et du dialogue / Pierre Claverie. – Cerf, 2004
[5] À lire : La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune / Pape François et Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb
[6] À lire : L’hospitalité divine : l’autre dans le dialogue des théologies chrétiennes et musulmanes / Fadi Daou, Nayla Tabbara.- LIT Verlag, 2013 et L’islam pensé par une femme / Nayla Tabbara.- Bayard, 2018