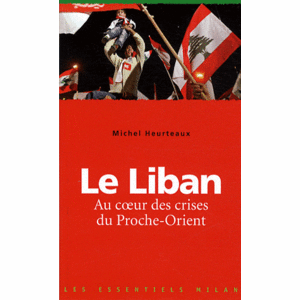 La collection « Les Essentiels » de l’éditeur Milan permet en une heure à un lecteur de consulter un ouvrage au format réduit et dont le texte devrait en si peu de mots donner « l’essentiel » d’un problème.Pour ce qui concerne le Liban, le mini ouvrage peut servir plus utilement de résumé à la manière de ceux destinés à préparer les oraux du bac qu’à rendre compte des « crises du Proche Orient » et du « Liban au cours de ces crises ».
La collection « Les Essentiels » de l’éditeur Milan permet en une heure à un lecteur de consulter un ouvrage au format réduit et dont le texte devrait en si peu de mots donner « l’essentiel » d’un problème.Pour ce qui concerne le Liban, le mini ouvrage peut servir plus utilement de résumé à la manière de ceux destinés à préparer les oraux du bac qu’à rendre compte des « crises du Proche Orient » et du « Liban au cours de ces crises ».
Monsieur Heurteaux a néanmoins consciencieusement, rassemblé les faits autour de trois points « essentiels » : politique surtout synchronique, économique et socio religieux.
Il est vrai que le facteur politique laisse paraître en filigrane, et à travers l’histoire, le facteur confessionnel. « Petit pays doté d’une histoire exceptionnelle » dit l’auteur mais surtout une histoire exceptionnellement tragique. Néanmoins, pour pallier les manques d’intérêt à se regrouper en une nation unifiée, les responsables libanais ont inventé un partage des pouvoirs entre les différents acteurs confessionnels durant l’Empire ottoman entre druzes et maronites et quelques autres minoritaires, puis sous le mandat français (1920-1947) et l’indépendance, une sorte de « démocratie confessionnelle » dominée par sunnites et maronites et donnant à chacune des 18 communautés religieuses reconnues une semi égalité. La Constitutionl’Etat garantit aux populations, A QUELQUE RITE qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel (mariage divorce et héritage étant codifiés par les tribunaux religieux de chaque communauté) et de leur intérêt religieux (liberté de pratiquer sa religion) ». C’est au Liban que le passage d’une religion à l’autre, surtout d’un rite musulman (sunnite, chiite, druze) au christianisme n’est pas sanctionné par l’Etat dans une région où l’apostasie entraîne des conséquences dramatiques. de 1926 stipule que «
La situation économique est alarmante. Un million de Libanais demeure sous le seuil de la pauvreté (moins de 3 euros par jour) dont 9 %, selon le PNUD, vit quotidiennement avec moins de 2 euros.
De 1982 à 1985, 40 000 miliciens armés, musulmans et chrétiens, se partagèrent les richesses minières, industrielles et les taxes portuaires sur les produits importés. De 1975 à 1990, les milices volèrent 7 milliards de dollars de biens, soit 50 % de l’économie nationale. Seul secteur où la crise ne s’est pas étendue, l’immobilier, dans la mesure où la diaspora libanaise a procédé à l’acquisition de 50 % des ventes. Le chantier du centre ville de Beyrouth, initié par Rafic Hariri, qui avait fondé la société Solidère, devrait durer jusqu’en 2015. D’autre part, 70 % des revenus du Liban proviennent du secteur tertiaire, mais les Emirats Arabes Unis et le Qatar semblent drainer une partie des investissements dans ce domaine.
Quant au partage des pouvoirs, l’occupation syrienne de trente ans (1975-2005) aura changé les cartes, suscitant à l’intérieur de chaque communauté des divisions qui minent l’unité nationale. Néanmoins, la démographie n’est pas favorable aux chrétiens (1,7 enfant par femme) et une émigration galopante des jeunes générations pour des raisons sécuritaires ou/et économiques). A partir de 1975, 600 000 Libanais fuirent leur pays en proie à la guerre civile dont deux tiers étaient chrétiens. Ainsi, en face des maronites (24 %), les chiites (28 %) et les sunnites (23 %) assurent, à la communauté musulmane dans son ensemble une large majorité, bien que la répartition des sièges de députés, décidée lors des accords de Taef (1971) se soit faite au bénéfice de la minorité chrétienne (50 % des députés pour 38 % de la population). Le Général Michel Sleiman, 59 ans, a été élu en 2009, comme douzième président de la République libanaise ; deux de ses prédécesseurs, nouvellement élus furent assassinés, Bechir Gemayel en septembre 1982, René Maawad (novembre 1989) ; il est vrai que deux présidents du Conseil, obligatoirement sunnites, furent eux-mêmes victimes d’attentats organisés sans doute par les mêmes commanditaires, Rachid Karamé et Rafic Hariri ; il est vrai que plusieurs de leurs prédécesseurs échappèrent à des attentats que ce soient Sami Solh ou Saëb Salam, tandis que le leader druze Kamal Joumblatt était assassiné en 1978. Les fonctions officielles dans ce pays sont à haut risque.
Les sunnites avaient l’habitude séculaire de représenter la majorité musulmane au Liban, mais depuis 1979, et la naissance de la Révolution islamo-chiite de l’Ayatollah Khomeïni à Téhéran, les chiites se sont mobilisés, devenus plus nombreux que les sunnites, pour bloquer l’action des gouvernements dirigés par un sunnite. Les sunnites, pour rétablir leur hégémonie, n’ont eu de cesse de faire naturaliser les 350 000 réfugiés palestiniens (140 000 en 1967) contenus, pour les plus pauvres, dans des camps poudrières où se disputent en batailles rangées d’ailleurs leurs factions. En 2007, dans le camp tripolitain de Nahr el Bared, 400 islamistes en rébellion contre l’Etat furent tués, et l’armée libanaise perdit 168 soldats. Chrétiens comme chiites sont opposés à la naturalisation des Palestiniens, que souhaiteraient obtenir les Etats-Unis et Israël.
Les chiites sont étroitement contrôlés par un parti d’inspiration populiste et même fasciste, le Hizbollah, qui leur assure, grâce à d’importantes subventions de l’Iran, une assistance sociale bienvenue, des écoles, des hôpitaux, et leur permet de s’exprimer haut et fort par les chaînes de télévision Al Manar. En juin 2005, le Hizbollah avec son féal Amal, obtint 14 députés sur 128 (11 % des voix) et des postes ministériels. En juillet -août 2006, une guerre de 33 jours de cette milice avec l’armée israélienne coûta la vie à 1 300 civils. En mai 2008, le Hizbollah prit le contrôle de Beyrouth Ouest, quartier traditionnellement sunnite et accessoirement druze, répandant la terreur et faisant plusieurs victimes. Surarmée, leur milice menace d’ailleurs toujours les quartiers sunnites. Les maronites se sont alors divisés pour adhérer au mouvement sunnite de Saad Hariri ou comme le Général Michel Aoun prendre le parti des chiites, ménageant ainsi deux fers au feu en cas de nouvelle conflagration générale.
La politique étrangère a été dirigée par la Syrie jusqu’en 2005 lorsqu’une réaction populaire libanaise a imposé, soutenue par une recommandation de l’ONU, un retrait des troupes syriennes. Mais la Syrie devenue satellite de l’Iran dirige la plupart des actions du Hizbollah et même favoriserait une partition de son voisin, ce qui servirait la politique d’Israël. Tel Aviv mena d’ailleurs contre le Liban six opérations militaires de 1948 à 2006. Entre ces deux voisins qui se disputent le protectorat sur le Liban, l’Etat n’est pas en mesure de défendre l’intégrité du territoire national. Le modeste budget de l’armée de 800 millions annuels est consacré, à 80 %, aux salaires.
Donc, la situation dans l’ensemble a été bien analysée. Il sera quand même nécessaire à l’auteur de corriger quelques erreurs. Page 13 « la religion maronite » n’existe pas ; le maronitisme est un catholicisme de rite syriaque. Page 17, remplacer « druizisme » par « druzisme » (est-ce l’influence des « druides » ?). Page 25, les Palestiniens se sont réfugiés au Liban dès 1948. Enfin, page 29, l’expression « palestino-progressiste » est datée, on a trop réduit le choc entre chrétiens, considérés comme nantis, et musulmans qui auraient tous été déshérités à la manière des réfugiés palestiniens. Soyons sérieux, les palestiniens ont été utilisés par la bourgeoisie sunnite, en 1975, pour contrebalancer l’influence chrétienne. C’est à ce moment-là que la Syrie dirigée par les alaouites, anti-sunnites, vinrent au secours des chrétiens qui risquaient l’anéantissement. Les « progressistes » étaient des deux côtés !
Le Liban est, comme l’aurait dit Hugo, un « grand petit pays ». On lui doit respect de son intégrité, connaissance de son histoire, admiration pour son rayonnement international. Christian Lochon membre du réseau Chrétiens de la Méditerranée

