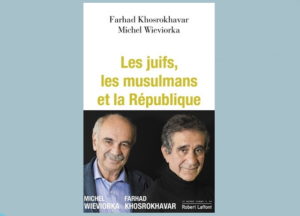Titre
Les juifs, les musulmans et la RépubliqueAuteur
Farhad Khosrokhavar et Michel WieviorkaType
livreEditeur
Paris : Robert Laffont, 2017Collection
Le Monde comme il vaNombre de pages
221 p.Prix
18,50 €Date de publication
23 octobre 2019Les juifs, les musulmans et la République
Farhad Khosrokhavar est directeur de l’Observatoire de la radicalisation à la Fondation Maison des sciences de l’homme. Il s’est intéressé à la révolution iranienne, à la place de l’islam en France et à son rapport avec la République. Il a dirigé de nombreuses recherches sur la radicalisation, notamment en prison[1].
Michel Wieviorka est directeur d’études à l’EHESS, où il a dirigé, de 1993 à 2009, le Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS) fondé par Alain Touraine en 1981.
Auteur de très nombreux ouvrages de sociologie politique, il s’intéresse particulièrement aux institutions républicaines et à leurs rapports avec les minorités.
Le livre se présente comme un dialogue entre les deux chercheurs, collecté par Bernard Sachs, pour cerner ce que sont les communautés juives et musulmanes en France et comment se nouent leurs rapports entre elles et avec la République.
La thèse défendue par les auteurs est originale : comment l’apaisement des rapports conflictuels des deux communautés peut être un moyen de redéfinir le rapport que la République entretient, non seulement avec elles mais avec d’autres communautés. Selon eux, loin de chercher un consensus commun, ces communautés peuvent confronter leurs différences, y compris dans ce qu’elles ont de plus radical, dans un dialogue rationnel permettant « le vivre ensemble ». C’est en ce sens que « le conflit » peut faire aboutir à des relations intercommunautaires apaisées à la condition qu’il existe un espace pour qu’il s’exprime, dans un débat soumis à la raison, dans une écoute mutuelle.
Mais les auteurs constatent que le modèle « républicain », considérant chaque individu comme un citoyen sans appartenance, sinon à celle de la nation, ne peut pas, de ce fait, permettre de promouvoir des lieux de débats communautaires : « son universalisme abstrait suppose qu’il est possible de reconstituer et de faire vivre un État-nation républicain, même dans un monde qui a changé. Et dans cette perspective, les particularismes n’ont pas à débattre ensemble car ils n’ont pas à apparaître visiblement dans l’espace public. » L’individuation de nos sociétés et l’effacement de corps intermédiaires ont fait le reste : « Les relations entre juifs et musulmans ne se comprennent donc pas si on ne fait pas intervenir, dans l’analyse, la République et la laïcité et si l’on ne les situe pas au sein d’une vision globale de la société française. »
De ce fait, la promotion du débat ne peut venir que du bas en s’exprimant depuis les communautés. Cette analyse dépasse de loin la question des rapports des communautés juives et musulmanes et remet en question ce que les auteurs désignent comme « républicanisme » pour promouvoir un modèle « néo républicain. « Dans une perspective néo républicaine, l’universel n’est pas en rupture avec le particulier, il constitue plutôt un principe de son aménagement et de son apprivoisement à partir de la dynamique où l’initiative provient de la société. L’État, dont le rôle serait constamment révisé, est alors dépositaire de ce sentiment d’appartenance, beaucoup plus que son créateur. C’est d’abord à la société civile de prendre des initiatives. »
En conclusion, les auteurs justifient leur hypothèse de départ : « L’enjeu du dialogue entre les communautés juives et musulmanes ne concerne pas seulement, ni principalement, la relation entre les deux groupes […] mais leurs relations pourraient permettre d’inventer un modèle assurant la vie collective en combinant le respect des valeurs universelles et la reconnaissance des particularismes. »
La réflexion des auteurs dépasse largement la question des relations entre juifs et musulmans. Elle interroge la pertinence du modèle républicain actuel. En ce sens elle s’inscrit dans les axes de recherches des deux sociologues. Cependant, la forme dialogique de l’ouvrage rend souvent difficile la compréhension du raisonnement et nécessite une relecture pour en avoir une vision globale.
Daniel Ollivier[2]
Collaborateur du Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme (CCEJ),
Faculté de Théologie, Université Catholique de Lyon (UCLy)
[1] Lire sur notre site, la recension du livre dont il est l’auteur avec Fethi Benslama : Le jihadisme des femmes : pourquoi ont-elles choisi Daech ?
[2]Sur notre site, on pourra lire de Daniel Ollivier, son Regard sur Jérusalem, la ville des deux paix et plusieurs recensions de livres : Ismaël et Isaac ou la possibilité de la paix / Gérard Haddad, Une patrie portative : le Talmud de Babylone comme diaspora / Daniel Boyarin, Les derniers jours de Moïse / Armand Abécassis, Moïse fragile / Jean-Christophe Attias.