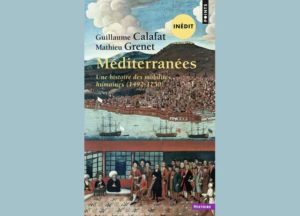Titre
MéditerranéesSous titre
Une histoire des mobilités humaines,1492-1750Auteur
Guillaume Calafat, Mathieu GrenetType
livreEditeur
Paris, Éd. Points, 2023Collection
Points. HistoireNombre de pages
558 p.Prix
15,90 €Date de publication
18 décembre 2024Méditerranées : une histoire des mobilités humaines, 1492-1750.
Dense et épais, cet ouvrage s’adresse d’abord à un public étudiant et spécialiste. Il répond en cela, de manière efficace, claire et documentée (bien que non illustrée malheureusement), aux exigences de préparation du concours de l’agrégation d’histoire, et plus spécifiquement de la question relative à la période moderne posée en 2023 : “Communautés et mobilités en Méditerranée de la fin XVe siècle au milieu du XVIIIe siècle”. Néanmoins, sa qualité rédactionnelle et la pertinence des analyses ici proposées en feront un instrument de lecture agréable pour tous les passionnés de l’histoire méditerranéenne et un outil de réflexion majeur pour tous les acteurs des relations interreligieuses.
Les auteurs, Guillaume Calafat et Mathieu Grenet, tous deux maitres de conférences en histoire moderne, passés par l’École française de Rome, appartiennent à cette génération montante d’enseignants-chercheurs soucieuse de répondre aux défis de notre temps. Ils proposent ici une solide synthèse historiographique, en dépassant la “bipolarité” qui singularise les études méditerranéennes depuis près d’un siècle.
Partant des “deux œuvres fondamentales” que sont La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II publié une première fois par Fernand Braudel en 1949, et A Mediterranean Society publié par Shelomo Dov Goeitein entre 1967 et 1988, les auteurs soulignent, dès l’introduction, que “l’un des traits structurants de l’historiographie du monde méditerranéen (…) consiste à questionner l’unité et la diversité de la région, c’est-à-dire les processus de cohésion et de fragmentation de cet espace maritime et des pays qui le bordent” (p. 14-15). Or, un autre courant historiographique qui s’inspire du Mahomet et Charlemagne publié par Henri Pirenne en 1937, et qui souligne l’antagonisme pluriséculaire entre islam et chrétienté, privilégie, quant à lui, une “Méditerranée de la frontière, pour ne pas dire du ‘choc’, entre deux “civilisations” (p. 15).
Entre ces deux pôles historiographiques, le présent ouvrage s’inscrit dans le sillage des chantiers scientifiques qui, depuis le début des années 2000, ont mis en relief l’étude des diasporas négociantes et des agents commerciaux, et ont scruté la Méditerranée comme “un espace d’échanges entre acteurs appartenant à des communautés politiques, religieuses et juridiques distinctes” (p. 20). Terrain propice aux histoires dites connectées et faisant écho à des travaux aussi variés que ceux portant sur l’esclavage, la captivité, la diplomatie culturelle ou bien encore la pratique de langues communes, “le monde méditerranéen est ainsi pensé aujourd’hui comme l’un des observatoires historiques privilégiés des circulations de personnes, de choses, de savoirs et d’idées à différentes époques” (p. 23).
En huit chapitres d’égales longueur et construction, ce livre propose donc une histoire des migrations et des diasporas, et “s’intéresse aux mouvements d’ensemble comme aux expériences de cohabitations plus localisées à l’échelle topographique des villes et des quartiers” (p. 25). Les passionnés auront ainsi plaisir à passer de Venise à Tunis, de Marseille à Istanbul, de Livourne à Cadix – les auteurs ayant pris soin de couvrir l’ensemble du monde méditerranéen y compris des régions qui, comme les Balkans, restent souvent moins connues du public français. Et répondant par là aux défis actuels, l’ouvrage “interroge plus largement l’histoire de la condition d’ ‘étrangers’ dans l’espace méditerranéen” (p. 25), dans les pays chrétiens et d’islam : Juifs, Arméniens, morisques mais aussi marins, consuls et pèlerins forment ainsi une véritable galaxie d’acteurs ballottée entre exils et appartenances, négoce, culture et “nations”.
L’angle des mobilités qui est donc privilégié ici permet ainsi de “tenir à distance aussi bien le refrain binaire et belliqueux de la guerre sainte” que son pendant “lénifiant du creuset des cultures et du cosmopolitisme” (p. 25). Cette objectivité que soutient une solide armature historiographique – à l’image de la notion de “cosmopolitisme communautaire” qui re-cadre celle de tolérance -, bouleversera plus d’un lecteur.
Les acteurs du dialogue interreligieux, souvent trop enthousiastes de la “rencontre des civilisations” ne pourront que bénéficier de “ce motif d’une Méditerranée1 non seulement traversée, mais maillée et comme équilibrée par ces interactions quotidiennes et ces interdépendances plurielles” (p. 529).
Rémi Caucanas2
Notes de la rédaction
1 Voir l’ensemble de nos recensions sur la Méditerranée
2 Ancien directeur de l’Institut Catholique de la Méditerranée (ICM, Marseille, France), et ancien secrétaire général adjoint du réseau Chrétiens de la Méditerranée, Rémi Caucanas est chercheur associé à l’Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabo-Musulman (IREMAM, Aix-en-Provence, France) et au Pontifical Institute for Studies in Arabic and Islam (PISAI, Rome, Italy). Professeur en histoire de l’Église et histoire des relations islamo-chrétiennes, il a enseigné au Tangaza University College (TUC, Nairobi, Kenya) de 2018 à 2021, et à l’Université Saint-Paul (Ottawa, Canada) en 2022. Il vit aujourd’hui à Belo Horizonte, au Brésil, où il a commencé une résidence post-doctorale à l’Université Fédérale du Minas Gerais (UFMG). Rémi Caucanas est intervenu en visioconférence à l’ouverture de l’Université d’hiver de CDM à Lyon (17-19 mars 2023). Voir aussi ses autres contributions et recensions de livres sur le site de CDM.