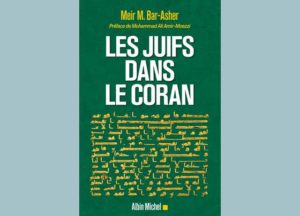Titre
Les juifs dans le CoranAuteur
Meir M. Bar-AsherType
livreEditeur
Paris : Albin Michel, 2019Collection
Présences du judaïsme pocheNombre de pages
281 p.Prix
17 €Date de publication
17 février 2020Les juifs dans le Coran
« La présence massive, dans le Coran, d’éléments appartenant ou issus du judaïsme intrigue orientalistes, islamologues et arabisants depuis près de deux siècles », souligne d’entrée de jeu le préfacier de cet ouvrage, l’islamologue Mohammad Ali Amir-Moezzi1. Cela intrigue parce que les liens entre le judaïsme et la naissance de l’islam sont encore mal connus.
Bon connaisseur de ces deux traditions religieuses, l’islamologue israélien Meir M. Bar-Asher2 tente d’éclairer ce sujet complexe en rappelant d’abord l’importance du judaïsme dans l’aire géoculturelle où l’islam a pris naissance : un royaume juif existait en Arabie, les Himyarites, un siècle avant notre ère mais son extension maximale aux IVe-Ve siècles va favoriser des liens intenses avec les tribus arabes de la péninsule arabique et dans le Hijâz où est né l’islam.
Peu de sources existent, malheureusement, pour connaître en détail ces liens et c’est donc à travers des réminiscences présentes dans le Coran que l’on peut tenter d’en savoir un peu plus.
On est en tout cas assuré que lorsque Muhammad fuit La Mecque et trouve refuge à Yathrib (plus tard appelée Médine) c’est dans un monde de communautés juives qu’il construit son premier Etat islamique. Un Pacte de bonne entente est passé avec elles, mais il ne sera pas toujours respecté et des traces de ces premiers conflits sont décelables dans le Coran. Le problème est que seules les sources musulmanes en parlent, ce qui engendre ce que l’auteur appelle « une asymétrie mémorielle », « source de beaucoup de malentendus ».
Plusieurs chapitres aident le lecteur à y voir un peu plus clair. Tout d’abord une analyse de la représentation du judaïsme et des juifs dans le Coran. Les « enfants d’Israël » sont souvent mentionnés, mais l’élection de ce peuple – l’Alliance de Dieu avec ce peuple élu -, est source de malaise pour l’islam qui considère que les juifs ont falsifié la Torâh, sont tombés dans l’idolâtrie et ont porté le message sacré « comme un âne qui ne sait pas ce qu’il a sur le dos ». Un autre chapitre s’emploie à détailler les récits bibliques et leurs prolongements post-bibliques présents dans le Coran : la Genèse, Caïn et Abel, Abraham, Joseph, David, Saül, les prescriptions sur la pureté sont repérables dans le Coran mais aussi dans la littérature post-rabbinique, les midrashim, que la tradition post-coranique appelle les isrâ’îliyyat. Le problème est que les récits sont tellement retravaillés, remaniés, que le thème de départ est souvent interprété autrement et peu lisible.
Quelle ressemblance y a-t-il entre loi juive et loi musulmane ? C’est une question importante à laquelle l’auteur consacre aussi un chapitre car les ressemblances sont importantes. Pour beaucoup de spécialistes, la prépondérance des aspects légaux dans le Coran médinois (les sourates d’après l’hégire) serait due à l’influence de la communauté juive locale. Les lois concernant la prière et son orientation géographique, le jeûne, les prescriptions alimentaires, le calendrier montrent, en effet, une indéniable influence de la culture juive ambiante, mais une analyse minutieuse montre aussi que les savants musulmans faisaient attention à se démarquer du judaïsme. La rigueur des prescriptions juives est souvent considérée par les auteurs musulmans comme une punition imposée par Dieu aux juifs à cause de leur infidélité.
La question de la dhimmitude et du statut accordé aux juifs relève d’une période post-coranique, lorsqu’un Empire musulman doit gérer les conditions d’existence de minorités religieuses vivant à l’ombre de l’islam. Le statut inférieur des dhimmis est codifié entre le VIIe et le VIIIe siècle dans le Pacte de ‘Umar par des califes hostiles aux juifs et aux chrétiens. Ce sont des lois discriminatoires qui, selon les chercheurs, se sont inspirées du droit byzantin et du droit sassanide, deux Empires rivaux où une religion d’Etat faisait un sort inférieur aux minorités religieuses3.
Un dernier chapitre traite de la place du judaïsme et des juifs dans le shiisme duodécimain, où l’on peut noter des variations importantes par rapport au courant dominant de l’islam. Plusieurs questions sont débattues : l’impureté des descendants d’Israël, les prescriptions concernant le mariage avec une non-musulmane. De manière assez générale, on observe un plus grand rigorisme des shiites vis-à-vis des gens du Livre (ahl al-kitâb) considérés comme impurs, ce qui a des conséquences sur le mariage, les pratiques alimentaires. Le paradoxe, souligne l’auteur, est que les shiites revendiquent volontiers une filiation exclusive avec le peuple d’Israël, peut-être à cause de la discrimination dont ils ont été l’objet au cours de l’histoire, comme le fut le peuple élu sous Pharaon.
Au total, on mesure la profonde ambivalence du Coran dans son rapport au judaïsme : d’un côté, l’attachement à la Torah est souligné, mais de l’autre le judaïsme est accusé d’avoir falsifié les Ecritures. Il en résulte une attitude ambivalente par rapport à la loi religieuse : on s’y rattache, comme à une source, mais pour s’en distinguer et manifester une différence.
L’auteur conclut en regrettant que le discours contemporain, contaminé par les questions politiques liées à la création de l’Etat d’Israël, ne reflète guère les complexités et les nuances de la manière dont le Coran considère les juifs. Cet ouvrage, on l’a compris, est plein d‘informations sur une question complexe, encore à l’étude, et aide à se faire un avis nuancé, ce qui n’est guère dans l’air du temps. Une bibliographie allant à l’essentiel complète utilement cet ouvrage qui met à l’abri des idées trop simples sur le sujet.
Jean Jacques Pérennès, op
Directeur
École biblique et archéologique française de Jérusalem
1 Note de la rédaction. Voir ses publications au catalogue de la BNF.
2 Meir M. Bar-Asher est directeur du département de Langues et Littératures arabes à l’Université hébraïque de Jérusalem. Il a également dirigé l’institut d’Etudes asiatiques et africaines de l’Université hébraïque de Jérusalem (2004-2006) et l’institut Ben-Zvi pour l’étude des communautés juives orientales et a présidé le Comité professionnel pour l’enseignement de l’arabe du ministère israélien de l’Education (2011-2012). Il a effectué toute sa formation à l’Université hébraïque de Jérusalem, mais a également étudié un an à Paris (Paris-III Sorbonne et EPHE) dans le cadre de son doctorat. (Présentation de l’éditeur, Albin Michel). Voir ses publications au catalogue de la BNF