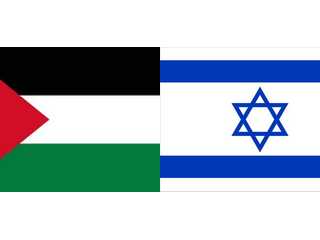Olivier Hanne donne le titre suivant, Les seuils du Moyen-Orient, à une synthèse qui éclaire la situation actuelle en Israël Palestine et dont l’ampleur est impressionnante. Une multiplicité de données y est prise en compte sur les millénaires d’histoire de cette région. Le titre est explicité par le sous-titre : “Histoire des frontières et des territoires”, qui place l’ouvrage à l’interface de l’histoire et de la géographie d’un Orient toujours dit “compliqué”. Son analyse a une portée très générale, elle ne se laisse pas sidérer par la complexité, et elle est pertinente sur l’ensemble des questions politiques du Moyen-Orient. Notons qu’il est entre autres professeur aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan.
Seuils, plutôt que frontières
Construite à partir d’un ambitieux parcours à travers les 5000 ans d’histoire de la région, sa thèse est la suivante : si, depuis les premières civilisations de l’histoire, on connaît des peuples qui y ont résidé, avec des territoires qu’ils habitent ou qu’ils conquièrent, jamais la définition des frontières n’y a été stable ni durable. Cela, qu’elles soient naturelles (on connaît le mode de construction de cette notion, le plus souvent ordonnée à une volonté politique), ethniques, linguistiques ou religieuses. Les peuples et groupes humains qui ont habité le Moyen-Orient depuis l’aube de l’histoire, en nomades ou en sédentaires, n’ont jamais eu tendance à établir des frontières fixes mais, autour des limites reconnues et toujours provisoires des espaces qu’ils fréquentent, se sont définis des passages ou des seuils qui ont aménagé entre eux des transitions, des lieux d’échanges aussi bien que de conflits. Et aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps, ce qui est aujourd’hui la Palestine, prise dans sa globalité, est l’un de ces seuils.
Le principe wilsonien de l’Etat-nation
L’actualité dramatique du Moyen-Orient remonte toujours à l’héritage de la Première guerre mondiale. Non que les bouleversements qu’elle a provoqués soient inédits dans son histoire, mais pour une raison actuelle et précise : les puissances victorieuses ont voulu plaquer sur cette zone le cadre de l’État nation, selon le principe avancé par le président Wilson du “droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”. Ce cadre, qui a favorisé évidemment la prise de contrôle des territoires en fonction des intérêts des vainqueurs, est loin d’aller de soi, même en Europe où il est né. Il résulte des convulsions des guerres de religion au 16ème siècle et pose qu’un territoire doit adopter la religion de ses princes : cujus regio, ejus religio. Invoqué d’abord lors de la paix d’Augsburg en 1555, ce principe de droit est dit westphalien parce que les traités de Westphalie (1648) l’ont pris pour base lors du rétablissement de la paix en Europe, après un siècle de troubles et une Guerre de Trente ans dévastatrice. Il n’a fonctionné en Europe (puis en Amérique) que sur la courte durée de cinq siècles, loin des millénaires de l’histoire de ce berceau de civilisations. Son évolution l’a laïcisé, prenant comme référence non plus la religion mais l’entité “nation”, née elle aussi à l’époque contemporaine, des trois révolutions fondatrices de l’Occident actuel, au Royaume-Uni, puis dans ses colonies américaines et en dernier lieu en France. Mais il est étranger à l’histoire multimillénaire des peuples du Moyen-Orient, où une certaine fluidité s’impose quant à la langue, à l’origine ethnique, au droit, aux modes de gouvernement, et aussi aux cultes.
États faillis
La clé offerte par Olivier Hanne ouvre de manière remarquable sur la situation actuelle de l’ensemble du Proche-Orient. Il note en effet que cette région, tout arbitraire que semble son découpage, n’en constitue pas moins une unité visible, largement distincte du monde indien et extrême-oriental à l’Est, de l’Afrique au sud, du Maghreb à l’Ouest et de l’Europe au Nord-Ouest. Mais à l’intérieur de cet ensemble, seule l’Égypte a gardé à travers les millénaires une identité encore actuelle, dans des frontières à peu près stables, ce qui pourtant ne lui épargne pas les tensions sociales et politiques. Alors que les États créés après 1918 apparaissent tous en crise, certes de manière plus ou moins dramatique, mais cependant souvent dans une instabilité sanglante. A commencer par la Turquie elle-même où l’intransigeant nationalisme, turc et laïc, de Mustapha Kémal a créé l’insoluble problème kurde. Liban et Syrie, Jordanie et Irak, les domaines que se sont attribués la France et le Royaume-Uni, sont toujours des lieux de tension plus ou moins extrême. Les guerres civiles, loin de s’apaiser, ressurgissent, le régime syrien s’est maintenu en éliminant un cinquième de la population de son territoire, et l’État islamique renaît en Irak, là où on l’avait cru écrasé. La péninsule arabe a vu l’ascension des monarchies pétrolières, mais sa périphérie reste marquée par le multiséculaire affrontement dont le Yémen est toujours la victime. Au point que le terme d’État failli semble taillé sur mesure pour ce qui affecte par excellence la Libye, autant que la Syrie et l’Irak, mais d’une manière plus ou moins aiguë toutes les populations de la région.
État nation du peuple juif
Parmi ces États mis après 1918 sous mandat européen avec l’aval de la Société des Nations, il faut situer le cas singulier de la Palestine, à laquelle le concept de seuil apporte son éclairage. La puissance mandataire y a délibérément fait appel à la colonisation sioniste pour y conforter son influence, îlot d’Occident dans un Orient étrange et insaisissable. De fait l’idée sioniste, dans l’esprit de Theodor Herzl et de ses autres promoteurs, est la transcription dans le cadre du judaïsme du concept de nation porté par les révolutions à travers l’Europe et l’Amérique. Le sionisme que le Royaume-Uni choisit de favoriser en Palestine sous la forme d’un “Foyer national juif”, selon les termes de la déclaration de Lord Balfour, ministre britannique des affaires étrangères, est une réalité laïque, à visée non pas religieuse mais clairement politique. Il s’agit d’un Etat-nation encore embryonnaire, vu le petit nombre de juifs vivant en Palestine du début du mandat. La Palestine, dans les décennies qui ont suivi jusqu’à aujourd’hui, est bien sortie du mandat britannique, mais pas de la manière prévue par la puissance mandataire. L’Etat d’Israël est apparu en 1948 comme le développement naturel de la colonisation favorisée par le Royaume-Uni mais en se retournant contre lui et en bafouant les intérêts de ses clients et protégés arabes.
On a souvent noté que l’Etat d’Israël ne s’est jamais donné de frontières terrestres. La logique sioniste, purement politique, le voyait dès l’origine comme destiné à recouvrir l’ensemble de la Palestine, de l’aveu même du père fondateur de l’État d’Israël David Ben Gourion. Pas de frontière, donc, mais des seuils, des glacis, des zones de transition dont résulte la conjoncture présente. Le Golan ne fait pas partie de la Palestine de l’histoire longue, l’État d’Israël l’a cependant annexé. Les visées de l’État d’Israël sur le Sud du Liban se sont traduites par des épisodes d’occupation dont rien ne prouve qu’ils ne se renouvelleront pas. Par contre Gaza, qui en fait partie, n’est plus revendiqué actuellement par l’État d’Israël car noyau dur d’une population palestinienne en croissance. La division des Territoires occupés, pris à la Jordanie en 1967, en trois zones, aux termes des accords d’Oslo, va dans le sens de cette relativisation des frontières. Même si les frontières extérieures d’Israël sont un chef d’œuvre de haute technologie dans le contrôle des passages, ce ne sont pas elles qui comptent le plus mais les murs et check-points intérieurs au territoire palestinien qui permettent une mainmise sur l’espace sans prise en charge d’une population citoyenne non-juive (Olivier Hanne p.386-389).
La loi sur Israël comme État-nation du peuple juif ne fait que proclamer ouvertement ce qui est la réalité d’un État “colonial” au sens strict du terme, un Etat d’étrangers s’installant sur une terre pour l’exploiter, dans leur seul intérêt et abstraction faite des occupants antérieurs. C’est l’aboutissement d’une série de crises que détaille Olivier Hanne, depuis la première guerre du Golfe jusqu’à “l’enfermement” physique des deux sociétés, israélienne et palestinienne, en coexistence forcée mais sans relation civile entre elles (p.431-435).
Au caractère fluctuant des frontières s’ajoute en Israël le flou sur l’appartenance religieuse. Le sionisme d’origine, radicalement laïc et souvent anti-religieux, inspiré en partie par les socialismes européens, se mêle aujourd’hui de revivalisme religieux et s’accommode d’un judaïsme ultra-orthodoxe. Cela se traduit dans les faits et dans le droit par la différence entre la citoyenneté et la nationalité.
“L’incertitude juridique entourant le statut de ses frontières [celles de l’Etat d’Israël] et de ses territoires fait du pays tout entier une ‘nation-frontière'”, constate Olivier Hanne (p.389)
Le malheur des chrétiens d’Israël Palestine et celui des chrétiens d’Orient
Le phénomène est plus général : les communautés chrétiennes d’Orient ne se sont jamais situées par rapport à l’État-nation. Leurs persécutions et leur exil en font les victimes majeures du principe de nationalité, “les grands perdants du XXe siècle”, dit Olivier Hanne. Le nettoyage religieux en Anatolie qui a culminé avec le génocide arménien de 1915 est l’expression d’un ultra-nationalisme porté par le mouvement Jeune-Turc avant même la première guerre mondiale. Les chrétiens d’Orient, descendants directs des premiers siècles du christianisme, se sont ainsi, paradoxalement, trouvés suspectés d’être les soutiens des Etats-nations européens modernes, qui affichent souvent leur détachement des appartenances religieuses, mais qui ont disposé souverainement, après 1918, des terres du Moyen-Orient sans grands égards pour leurs populations.
Réaménager la coexistence des communautés dans leurs différents niveaux d’identité
Les conclusions d’Olivier Hanne vont dans le sens de ce que cherchent, pour la plupart, les “acteurs de paix” au Moyen-Orient. Il insiste sur les droits des personnes, qu’ils soient civiques, politiques, ou économiques et sociaux, dans la pluralité de leurs appartenances, de leurs solidarités familiales et de proximité, de leurs traditions en particulier religieuses. Cela consonne, par exemple, avec ce que nous avons rencontré dans ce dossier sur la situation en Israël-Palestine. C’est ce que les intellectuels palestiniens de Shabaka préconisent, ce que Thomas Vescovi avance dans son entretien en vidéo donné à notre site. Une même volonté de se construire comme peuple à travers l’éducation, l’expression culturelle et les actions de solidarité anime Ziad Medoukh, universitaire et poète, professeur de français à Gaza, et le docteur Abdelfatta Abusrour, intervenant en visio-conférence pour les Amis de Sabeel France, à propos du Centre Al Rowwad qu’il a fondé au bénéfice des jeunes des camps de réfugiés de Cisjordanie. Il ne faut pas trop croire au redécoupage des frontières et à l’établissement d’États, qu’ils soient centralisés ou fédéraux. Ils apparaissent partout comme la projection d’intérêts étrangers, pas seulement occidentaux d’ailleurs, mais se cherchant des clientèles, soucieux davantage des intérêts de leurs commanditaires que des populations des territoires.
C’est ce qu’Olivier Hanne avance dans sa conclusion (p.467-8).
Il cite le grand économiste et politologue libanais Georges Corm :
“Sans solution à la question identitaire, le Proche-Orient ne pourra pas connaître de régimes politiques vraiment légitimes et qui pourraient, de ce fait, laisser s’exprimer librement ce pluralisme politique ou identitaire”.
Au risque que ressurgisse une nouvelle guerre des seuils, à l’instar d’Al Qaïda et de Daech, il préfère une “instabilité politique” qui fasse droit à la cohabitation “d’une constellation d’autorités ethniques, régionales et religieuses variant d’une zone à l’autre, installées fermement sur des territoires”, de sorte qu’il y aurait “une sorte de statu quo régional, aucun pouvoir ne pouvant l’emporter définitivement sur les autres ni se maintenir sans négociations ni compensations pour les minorités”. C’était plus ou moins l’état de fait de l’empire ottoman au long du 19ème siècle. Cela, à condition toutefois “qu’aucune puissance extérieure n’utilise le droit d’ingérence pour imposer se vues dans la région”.
Olivier Hanne dessine peut-être ainsi un compromis, un modèle de contrepoids à la tendance lourde vers l’uniformisation et la convergence des pouvoirs qui semblent marquer notre monde, rendu toujours plus interdépendant par le biais de la science et de l’économie.
Jean-B. Jolly
Membre du bureau de CDM