“Rencontrer l’autre signifie qu’on a une espérance pour lui”
C’est par cette belle formule que Gérard Testard (1) conclut le texte qu’il nous a adressé à propos du dialogue inter-religieux, riche réflexion conduite à partir de l’expérience du mouvement Ensemble avec Marie (2), fondé en 2015, qui se consacre à la rencontre entre chrétiens et musulmans, en partant du constat que notre époque voit monter une incommunicabilité qui met en danger le sentiment d’appartenir à la même humanité. 42 rencontres réparties dans 13 pays européens et d’Afrique subsaharienne ont été ainsi réalisées en 2019 sous la figure emblématique de Marie dont Gérard Testard rappelle à juste titre qu’elle est vénérée dans les deux religions chrétienne et musulmane. De cette expérience considérable, il tire la conviction que “la fracture” n’est pas entre chrétiens et musulmans, mais entre d’une part ceux qui cherchent à promouvoir un mode harmonieux de vivre ensemble et d’autre part ceux qui militent pour fragmenter la société.
Pour Claude Popin, “le dialogue n’est ni ringard ni obsolète mais plus que jamais nécessaire et à réinventer dans une société malade d’en manquer”, écrit-il dans un article où, fort de l’expérience d’ Unidivers (3) il décrit très justement les périls que court aujourd’hui le dialogue dont le fondement est “d’admettre que l’autre peut lui aussi avoir quelque chose de neuf à partager”.
(1) Gérard Testard est impliqué dans le dialogue inter religieux depuis de nombreuses années, ancien Président de la communauté Fondacio, co-fondateur de L’Observatoire Pharos, est Président de l’association Efesia, www.efesia.org, qui se situe “au cœur de la rencontre chrétiens-musulmans et de l’action auprès des plus démunis”. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont “Quelle âme pour l’Europe”, Editions Nouvelle Cité, 2012.
(2) Ensemble avec Marie, ensembleavecmarie.org, est un mouvement fondé par l’association Efesia. Partant de la proximité des deux récits de l’Annonciation dans l’Evangile et le Coran, il est dédié à la rencontre, notamment entre chrétiens et musulmans.
(3) Créée il y a près de vingt ans, l’association Unidivers dont le siège est à Annecy est une association également consacrée à la rencontre, en particulier au dialogue interreligieux. Claude Popin qui participe très activement à son animation est un fidèle soutien de CDM et en particulier de sa rubrique “A découvrir” à laquelle il fournit de très régulières contributions.
–o–
Ensemble avec Marie
Pour une culture de la rencontre
Gérard Testard
Dans notre monde moderne, miné par les replis identitaires de toutes natures, et qui se manifestent sous la forme d’individualisme, de communautarisme, de nationalisme…, les sentiments d’appartenance à la même humanité sont mis en danger. Notre société semble de plus en plus fragmentée, la peur générée par une méconnaissance de l’autre (religion, ethnie, culture, corporation, etc.) engendre la violence, et la paix est menacée (idéologies totalisantes, extrémismes…).
C’est dans ce contexte qu’est né en 2015 le mouvement Ensemble avec Marie, qui propose la rencontre entre chrétiens et musulmans. C’est un mouvement spirituel, populaire et citoyen qui réunit des personnes de bonne volonté, des familles et des associations, et promeut la “culture de la rencontre”. En effet, un enjeu de ce temps touche à “l’altérité”, la capacité à rencontrer l’autre, différent. Par une pédagogie appropriée, Ensemble avec Marie encourage à “sortir aux périphéries”, à se connaître, à lutter contre les clichés, déconstruire des préjugés et faire échec aux conflits liés à l’ignorance. La finalité d’Ensemble avec Marie est bien de promouvoir la paix, et la fraternité entre tous les hommes, dans le respect des diversités. Il s’agit de construire un socle commun et permettre de vivre un pluralisme faisant place aux diversités par opposition à un multi-culturalisme ou toute forme de communautarisme. Aujourd’hui, en effet, la fracture ne semble pas être entre chrétiens et musulmans. Elle est entre ceux qui veulent plus d’unité, d’harmonie et de vie ensemble, et ceux qui cherchent à fragmenter la société.
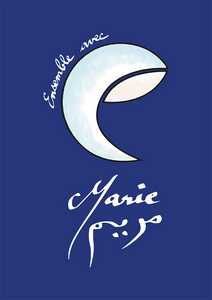
La figure emblématique de Marie, présente et vénérée dans les deux traditions, chrétienne et musulmane, facilite la rencontre. Pour les chrétiens comme pour les musulmans, Marie a reçu de l’ange Gabriel l’annonce de la naissance virginale de son fils. Marie est la seule femme à être citée par son nom dans le Coran, et à 34 reprises. Une sourate entière lui est dédiée. Pour les chrétiens, Marie est la mère de Jésus, fils de Dieu, mère de tous les hommes. Pour les croyants des deux religions, Marie est un modèle de foi et de fidélité en Dieu.
Ainsi, Ensemble avec Marie rassemble des chrétiens et des musulmans de tous horizons, désirant témoigner, à travers la rencontre des personnes, dans le respect de l’identité de chacun, que ce qui les rassemble est plus fort que ce qui les sépare.
Concrètement il s’agit de constituer, dans chaque ville qui désire s’engager, des groupes locaux de chrétiens/musulmans qui, en se rencontrant, se connaissent mieux, développent de solides amitiés, discutent ferme certains aspects de leur religion quand c’est nécessaire, pour avancer dans la vérité. C’est aussi en construisant un programme pour la journée annuelle et en organisant leur animation que de belles et saines confrontations ont lieu. En définitive, ce n’est pas d’abord la qualité des intervenants et leurs apports, même érudits, qui comptent le plus lors de la cérémonie, mais l’amitié, construite au fil du temps, qui se transmet.
Des rencontres rassemblant de cent à mille personnes proposent des apports d’intervenants qualifiés, de prières, témoignages, chants et musique, symboles… En 2019, 42 manifestations ont été réalisées sur 13 pays en Europe et en Afrique subsaharienne principalement.
Outre ces événements annuels dans les villes où se constituent des comités locaux, des initiatives ont été prises pour des rencontres Ensemble avec Marie en milieu carcéral. De plus, un programme pédagogique est en cours d’élaboration actuellement à destination des jeunes adolescents dans des établissements scolaires. Diverses associations chrétiennes et musulmanes sont engagées avec Ensemble avec Marie et c’est l’association EFESIA, reconnue canoniquement par l’Eglise catholique qui assure le support juridique et opérationnel.
La “culture de la rencontre“ n’est pas seulement une formule. Rencontrer l’autre signifie qu’on a une espérance pour lui. S’intéresser à son histoire, le visiter, aller sur son propre terrain, lui refléter la valeur de son parcours, prendre en compte son identité ou des traits de sa personne, est créateur d’amitié, de proximité, d’affinités ou de liens de paix. C’est particulièrement vrai avec les musulmans comme avec les pauvres, les immigrés…
Gérard Testard
Président d’Efesia
–o–
Un dialogue impossible? (1)
Claude POPIN
Les mots vieillissent, hélas ! Ou bien, pour pasticher Ronsard, ne serait-ce pas plutôt nous qui vieillissons ? Mais c’est la réalité d’une langue vivante : des mots sont “à la grimpe“, comme le “confinement“ aujourd’hui, d’autres sont à la baisse, comme le “dialogue“, dans lequel pourtant on a longtemps cru, et qui a maintenant un arrière-goût de vieillot, ringard, obsolète, sinon de naïveté. Il fut un temps, pas si lointain (moins de 30 ans), où l’Institut de Science et théologie des Religions (ISTR) de Marseille lançait sa revue Chemins de dialogue (2). Il y était explicitement question du dialogue interreligieux. UNIDIVERS, association locale née à Annecy en 2002, ambitionnait “le dialogue des cultures et des religions“.
Aujourd’hui, on ne dialogue plus : on vocifère, et pire encore… On assène “la“ vérité (fut-elle fausse) avec une certaine violence qui ne supporte aucune contestation, on la proclame, on la jette à la tête de l’autre, on mobilise tous les moyens pour la faire entendre, soit du haut d’une tribune ou lors d’une manifestation, de passages à la télé, de chroniques dans les journaux, de publications ou, mieux encore, de saturation des réseaux sociaux.
Cet impossible dialogue, ou sa confiscation par des vociférateurs, s’enracine dans une société en perte de repères et de la notion de bien commun. Le progrès matériel s’est tellement appliqué à satisfaire tous nos besoins (réels ou suggérés), qu’il a hypertrophié l’individu-consommateur, au détriment de la personne sociale. Cela explique, dans une certaine mesure, le règne de l’individualisme, bien souvent dénoncé par des esprits perspicaces : si chacun a légitimement tous les droits, que se passe-t-il quand il se heurte aux droits des autres ? Celui qui crie le plus fort aurait-il plus de droits que les autres ? “La raison du plus fort est toujours la meilleure“, déplorait déjà La Fontaine.
Dans le même temps, et en corollaire, on a vu monter la priorité accordée à l’émotion, au ressenti personnel. La vérité, c’est ce que chacun éprouve dans l’immédiateté du moment. Il n’est plus question de pensée et de réflexion, mais simplement du sentiment comme unique moteur d’action. D’ailleurs, il est significatif que, sur les réseaux sociaux, on ne trouve pas de dispositif de “réflexion“, mais simplement un émoticône pour “liker“ si vous aimez… Les épisodes du Covid 19, les attentats terroristes, les violences des casseurs ou de certains policiers, la disparition d’une célébrité, par exemple, suscitent, une telle émotion que des foules se rassemblent et que les politiques se remuent. Puis ça passe avec la fugacité des sentiments, et on oublie, en attendant le buzz suivant…
Pourtant, il en est un qui persiste et dessine comme une toile de fond : c’est la peur. La mondialisation a fragilisé et transformé les économies, des emplois sont perdus, de nouvelles pratiques s’instaurent. Crainte du chômage, du déclassement, de l’avenir. Peur de l’autre, du migrant, de celui “qui n’est pas comme nous ou pas de chez nous“. Porte ouverte à tous les fantasmes et tous les complotismes. La pandémie d’aujourd’hui ne fait que renforcer ce climat anxiogène peu favorable au dialogue.
Au moins, pouvait-on espérer que les réseaux sociaux si bien nommés, allaient renforcer les liens et permettre les échanges. Bien utilisés, ils ont constitué, pour la communication et la diffusion du savoir, une révolution à la hauteur de celle de l’imprimerie à la Renaissance, un changement de civilisation, avec ses corollaires inattendus. Par les réseaux sociaux, chacun peut tout savoir sur tout. D’où cette prolifération de “spécialistes“ en tous genres, ce qui pose la question de la transmission : qu’avons-nous encore à apprendre des autres ou aux autres puisque toutes les informations sont à disposition ? Et elles le sont immédiatement, en un clic. Avoir tout, tout de suite, au moindre désir, c’est donner la priorité à l’urgence, autre caractéristique de notre époque qui ne sait plus composer avec la maturation du temps. Loin de “faire société“, ces réseaux isolent souvent les individus dans une “tribu“ fermée, chacun ne communiquant plus qu’avec ceux qui lui sont semblables. C’est de “l’entre-soi“. Outre la confusion entre le virtuel et le réel, les réseaux sociaux charrient le meilleur des savoirs et des échanges comme le pire de la bêtise, des ragots, des mensonges, voire des appels aux meurtres. C’est bien connu : “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme“ (3).
Cette conscience doit réintroduire de l’humain dans une société de mutations technologiques et économiques qui bousculent les pensées et les croyances, et il semble urgent d’y réhabiliter la notion de dialogue. Étymologiquement, le mot évoque une parole qui passe de l’un à l’autre. C’est plus que “la conversation et l’échange“ du Larousse (4) et bien plus encore que la “tolérance“ prônée par le Petit Robert (5). Dans son livre Le dialogue pour tous (ou presque) (6), Dennis Gira, spécialiste de l’interreligieux d’origine américaine, enseignant à Paris, donne la définition suivante : “Le dialogue est un échange de paroles et une écoute réciproque engageant deux ou plusieurs personnes, à la fois différentes et égales“. Chaque mot porte dans cette définition empruntée à J.-C. Basset (7). La lecture de cet ouvrage peut laisser perplexe. Presque tout ce que l’auteur préconise pour réussir le dialogue, ses règles d’or, ses mots-clefs comme le respect, l’humilité, la patience, l’écoute, etc. se situe en contradiction avec l’esprit et les pratiques de notre société, telle qu’évoqués ci-dessus. Entrer en dialogue aujourd’hui, c’est faire acte de résistance à ce qu’un autre chroniqueur de l’hebdomadaire La Vie appelle la “décivilisation“. (8)
Alors, le dialogue interreligieux aujourd’hui ? “Plus que jamais nécessaire“, affirme Dennis Gira. “Sans dialogue interreligieux, les conflits de certaines régions du monde ne feront qu’empirer. Tout le monde est appelé au dialogue parce qu’il est l’une des conditions de la paix dans le monde“. Mais, rappelle-t-il, “les –ismes ne dialoguent pas entre eux“. Christianisme, bouddhisme et autres, ce ne sont que des notions abstraites : seules des personnes peuvent entrer en dialogue quand elles ont, au préalable, évacué toutes les idées reçues véhiculées sur leurs appartenances et sont prêtes à relativiser quelques certitudes pour comprendre le point de vue de l’autre. Le dialogue ne se commande pas. Si l’un n’est pas demandeur, rien ne se passera. Certes, le Français de tradition catholique que je suis n’a guère envie de dialoguer avec le porteur de couteau, kalachnikov ou autre ceinture d’explosifs. Mais je comprends que n’importe quel musulman soit tout aussi heurté dans sa croyance par des caricatures, qu’on a cru bon de projeter sur des bâtiments publics en Aquitaine et en Occitanie, ce qui est d’une rare bêtise. “On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui“, disait sagement Desproges. Où est le respect minimum dans tout cela ?
La laïcité, instaurée sans être nommée dans la loi de 1905, aurait pu et dû être un facilitateur de dialogue, puisqu’il est dit que “l’Etat reconnaît toutes les religions“ dans la liberté de conscience de chacun. Hélas ! Un laïcisme dévoyé en a fait une arme de guerre contre les religions. “Les religions n’ont pas leur place à l’école, un point c’est tout“, a martelé, le 22 octobre dernier, la Secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement, Sarah El Haïry (9). C’est oublier un peu vite que, si la première mission de l’école est de transmettre du “savoir“, elle ne peut la réussir qu’en étant attentive à la totalité de la personne de l’élève, dans toutes ses composantes : intellectuelles, familiales, culturelles, ses désirs, voire ses rêves… bref, dans ce qui le motive. Certains mythes ou récits fondateurs ont plus de force d’impulsion qu’une information, même sensationnelle. Jean d’Ormesson écrivait : “On ne meurt plus pour ce qu’on sait, mais on est encore capable de mourir pour ce qu’on croit“ (10).
A UNIDIVERS, si nous avons quelques convictions humanistes et laïques, nous n’avons pas de certitudes à imposer. Nous sommes conscients que, pour dialoguer, il faut d’abord connaître l’autre dans ce qu’il est, ce qu’il vit et ce qu’il croit. D’où les conférences, rencontres et voyages organisés régulièrement, ainsi que la publication d’informations. C’est le côté “savoir“, un peu intellectuel, que d’aucuns jugent trop timoré et pas suffisamment en phase avec les urgences économiques et sociétales d’aujourd’hui. Pourtant, nous sommes convaincus que tout ce qui est humain constitue notre horizon, voire notre utopie. Pourraient en témoigner ceux qui ont participé au voyage de septembre 2019 en Europe : Verdun, Bruxelles, Strasbourg, ou comment passer de la guerre à la paix par l’institution d’un dialogue entre les nations. Ou encore, en octobre 2020, sur le plateau d’Assy en Haute-Savoie, comment l’art architectural ou sacré a pu transcender les difficiles conditions de vie des malades isolés par la tuberculose…
Ainsi, que ce soit dans le monde de l’éducation comme dans celui des rapports sociétaux, le dialogue n’a plus la cote aujourd’hui. Il appartient à cette sphère de la “croyance“, moins vérifiable, semble-t-il, que celle du “savoir“. L’individualisme, la peur de l’autre, la primauté accordée au ressenti personnel, autant de tentations de se réfugier dans quelques vérités simplistes qui rassurent. Or, dialoguer, c’est admettre que l’autre peut, lui aussi, avoir quelque chose de neuf à partager, c’est nous exposer à la fragilité de nos propres savoirs et croyances, c’est le risque de voir bousculer notre petit monde intérieur. Bref, c’est l’inconnu et le début d’une aventure qui peut conduire vers de larges horizons inexplorés.
Qu’en politique comme en religion, on puisse se recroqueviller frileusement sur des certitudes héritées du passé, c’est une chose. Mais le dynamisme et la vie sont du côté de ceux qui osent, qui avancent et qui ouvrent des “chemins de dialogue“. Qu’on se rassure, le dialogue n’est ni ringard, ni obsolète, mais plus que jamais nécessaire et à réinventer dans une société malade d’en manquer.
Claude POPIN
27 décembre 2020
________________________________________
1. Titre d’un article de Laurent Grzybowski, dans l’hebdomadaire La Vie, n° 3924, du 12 au 18 novembre 2020.
2. N° 1. 1993.
3. Rabelais. Pantagruel livre II.
4. Le Petit Larousse, éd. 1996.
5. Le Petit Robert, éd. 2012
6. Dennis Gira, Le dialogue pour tous (ou presque). Ed. Bayard. 2012
7. Jean-Claude Basset, Le dialogue interreligieux. Chance ou déchéance de la foi, Ed. du Cerf, coll. “Cogitatio fidei”, 1996.
8. Chronique de Gaël Brustier, La Vie, numéro cité ci-dessus.
9. Voir La Vie, numéro cité et Le Monde, n° 23596 du 19 novembre 2020.
10. Jean D’Ormesson, Un hosanna sans fin (posthume). Ed. Héloïse D’Ormesson. 2018.


