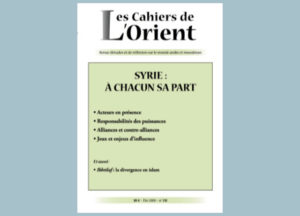Titre
Syrie : à chacun sa partSous titre
Dossier de la revue Les Cahiers de l’Orient, n°131Auteur
sous la direction d’Antoine Sfeir ; coordination, Frédéric PichonType
livreEditeur
Paris : Les Cahiers de l’Orient et le Centre d’études et de recherches sur le Proche-Orient (CERPO), été 2018Nombre de pages
166 p.Prix
18 €Date de publication
21 février 2019Syrie : à chacun sa part
Cette livraison de la revue Les Cahiers de l’Orient offre un démenti à ceux qui pourraient penser qu’une revue ne peut être que partielle et éphémère, parce que trop datée. En quatorze articles, denses et diversifiés, sous la plume d’une douzaine de spécialistes du Proche-Orient[1], le lecteur est convié à faire le point sur une situation de guerre qui dure depuis plus de sept ans. Et cet « arrêt sur image », ou ce point focal, devient un outil essentiel, non seulement pour constater et comprendre ce qui s’est passé, mais pour éclairer et discerner les perspectives nouvelles de la recomposition de la région.
Au point de départ : trois chapitres généraux sur l’histoire de la Syrie, les acteurs et les conditions géopolitiques. Les auteurs, à défaut de pouvoir être exhaustifs, donnent les principales clefs de compréhension de cette guerre interminable. Les différentes populations, rassemblées sur ces « terres syriennes », se sont souvent affrontées et ont mis longtemps avant d’acquérir une conscience nationale. Cela s’est opéré à la fois à cause et malgré des interventions extérieures, qu’elles viennent de l’Empire ottoman, du « mandat » occidental ou des pressions du nationalisme arabe (voir l’éphémère République Arabe Unie avec l’Égypte, de 1958 à 1961[2]).
Dès le quatrième article, on entame ce qui constitue l’axe principal du numéro de la revue et qui en justifie le titre : « À chacun sa part » : ce sont les interventions extérieures. Tour à tour vont apparaître les États-Unis, la Turquie, le Qatar et l’Arabie Saoudite, les djihadistes de Daech, la France et l’Angleterre, les Kurdes syriens ou turcs, l’Iran et la Russie, sans compter la vigilance israélienne. En ordre dispersé, – chacun avec son diagnostic erroné ou non, avec ses intérêts plus ou moins avoués – ces différents acteurs peuvent donner raison au vice-ministre des Affaires étrangères de Damas qui dénonce l’internationalisation de la guerre et considère que Bachar Al Assad reste le garant de l’unité de la nation syrienne. Les politiques des différents intervenants sont naturellement disparates et très fluctuantes au gré des événements.
Il faut lire les analyses pertinentes de chacun des auteurs qui, tous, s’interrogent sur les motivations et les enjeux, à la fois politiques, économiques ou religieux. Après la timide coalition États-Unis, France et Grande-Bretagne contre Daech, le désengagement américain commencé sous Obama et poursuivi par Trump, qui n’agit plus qu’en sous-main par Kurdes interposés, il apparaît, en cet été 2018, que sont en recul à la fois l’Occident et la mouvance de l’islam politique. En revanche, des pourparlers de paix se sont tenus à Astana (Kazakhstan) entre la Russie, l’Iran, la Turquie et la Syrie de Bachar Al Assad : ils sont symboliques de l’effondrement occidental et arabe et annoncent une recomposition de la géopolitique du Proche-Orient.
Les derniers articles s’interrogent déjà sur l’après-guerre, à la fois politique (quelle sera la place des Kurdes dans la Syrie ?) et culturel (comment reconstruire et restaurer les villes et les monuments détruits ?). L’après-guerre ? Ce sera sans doute « le retour d’empires aux intérêts divergents… L’empire russe s’intéresse aux ressources énergétiques de la Syrie ; l’empire turc néo-ottoman intervient au-delà de ses frontières par hantise de la contagion autonomiste kurde ; l’empire perse, en instrumentalisant le chiisme, consolide un arc stratégique du Yémen à la Syrie et devient une puissance méditerranéenne ». Ces lignes sur la recomposition du Proche-Orient sont les premières de l’éditorial d’Antoine Sfeir dans cette revue. Et c’est sans doute le dernier texte qui portera sa signature dans ses Cahiers de l’Orient qu’il a initiés. On ne peut que saluer la mémoire de ce spécialiste de l’Orient, mort le 01/10/2018, et reconnaître sa clairvoyance et la pertinence de ses analyses, partagées par tous ceux à qui il a permis de faire le point sur la Syrie d’aujourd’hui. Ainsi, Frédéric Pichon, coordinateur de ce numéro, pourra-t-il écrire à sa suite : « La guerre régionale qui se joue en Syrie est devenue le symptôme de l’agonie d’un ordre international en même temps que les prémices de celui qui s’annonce ».
Claude Popin
[1] Voir leur nom en cliquant sur : le sommaire de ce n°131