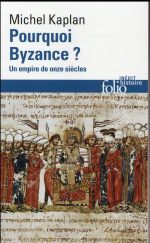Titre
Pourquoi Byzance ?Sous titre
Un empire de onze sièclesAuteur
Michel KaplanType
livreEditeur
Gallimard, 2016Collection
Folio. Histoire; 252Nombre de pages
490Prix
8, 80 €Date de publication
14 janvier 2017Pourquoi Byzance ?
Notre actualité répondrait-elle à la question du titre ? Sans aucun doute, si l’on suit la démonstration que propose l’auteur dans son prologue. Cet universitaire, spécialiste des études byzantines auxquelles il a consacré sa vie, écrit l’histoire comme si c’était la nôtre. Sans en être les acteurs ou les témoins, nous en sommes encore les héritiers.
Tout a commencé en 324 lorsque Constantin fait de Byzance, position stratégique sur le Bosphore, la capitale de l’Empire Romain. Ce sera Constantinople. Seul vainqueur de ses concurrents, augustes ou césars, le nouvel homme fort asseoit son pouvoir sur une nouvelle sacralité : celle du Dieu unique que revendiquent les chrétiens jusqu’alors persécutés. Mais il se rend vite compte que ceux-ci sont partagés sur le fait de savoir si Jésus est ou n’est pas vraiment Dieu. Toute division étant nuisible au pouvoir absolu, Constantin se mêle de théologie, convoque et préside lui-même un Concile à Nicée en 325. Le ton est donné. Héritier de Rome, le nouvel Empire se construit sur l’utilisation du divin au service du politique et sur le paradigme de son universalisme puisqu’il s’étend à peu près sur tout le monde connu de l’époque. Il est « romain, chrétien, oriental de langue grecque », et l’Empereur se proclame « en Christ le Dieu fidèle, autokrator des Romains ». Il sera toujours le « lieutenant de Dieu sur terre ».
Toutes les caractéristiques de cet empire qui va durer onze siècles sont déjà perceptibles dès ses débuts. Vastes territoires qui englobent des peuples de langues et de cultures différentes. Pouvoir absolu et sacré de l’Empereur (plus sacré même que celui des païens successeurs d’Auguste, mais c’est la même conception…). En 843, ce sera encore un Empereur qui règlera une grave affaire religieuse : fallait-il autoriser le culte des images ? Une administration décentralisée mais efficace pour maintenir une large cohésion et une économie viable. Une juridiction exemplaire (code Justinien, par exemple, souvent amendé) pour que toujours « le droit prime la force ». Et une continuité remarquable dans la succession des Empereurs en trois ou quatre dynasties seulement.
L’histoire factuelle est longue, depuis que Rome en 476 est tombée aux mains des « barbares ». Byzance s’inscrit dans la continuité de Rome, à la conjonction de deux continents. C’est la Porte de communication entre l’Orient et l’Occident (la Sublime Porte, dira-t-on au temps des Ottomans…). On ne reviendra pas ici sur les innombrables péripéties historiques. Il sera intéressant de découvrir, en fin d’ouvrage, une série de cartes témoignant du lent rétrécissement du territoire de cet Empire, sous les pressions successives des différents envahisseurs barbares et de la poussée de l’Islam, d’abord par les tribus arabes puis par l’emprise des Turcs d’Asie. En 1453, à la chute de Constantinople, voilà presque deux siècles que les Empereurs byzantins ne régnaient plus que sur des confettis d’empire.
Mais au fil de cette histoire, on découvre, en filigrane, la construction de notre propre monde. D’abord cette rupture avec un Occident qui a, le plus souvent et au contraire de Byzance, distingué pouvoir civil et pouvoir religieux. Aux yeux de l’auteur, le « schisme » de 1054 est beaucoup plus politique et culturel que théologique. La vraie cassure s’effectuera en 1204 quand les Vénitiens de la quatrième croisade saccageront Constantinople. Le traumatisme sera durable au point que, plus tard, beaucoup préféreront « vivre sous le turban plutôt que sous la mitre ». Rupture politique, mais en même temps, circulation des savoirs. Les textes des Grecs anciens arriveront dans une Europe à peine sortie de son Moyen-âge, et ce que nous appelons « la Renaissance » impulsera le nouveau dynamisme occidental.
Car, à Constantinople[1], que les Turcs musulmans ont longtemps rêvé de conquérir, c’est la continuité et la stagnation. Hormis la langue et la religion, les Sultans ottomans sont toujours les mêmes autocrates politiques et religieux que leurs prédécesseurs, à tel point que le cérémonial ne varie guère et que les mosquées construites ressembleront toutes à Sainte-Sophie. La même prétention à l’universalisme habitera les Sultans turcs : ils se rendront maîtres des Balkans, s’avanceront jusque Vienne, contrôleront l’Orient et la Méditerranée comme l’empire byzantin. Les chrétiens d’Orient, tolérés seulement dans le nouvel Empire, ne joueront plus de rôle déterminant. Et cela profitera à un nouveau venu au nord, héritier autoproclamé de Byzance, qui se dira « Tzar » (César) de toutes les Russies, en transférant sa capitale de Kiev à Moscou, « la troisième Rome ».
Lire l’ouvrage de Michel Kaplan, c’est donc se plonger dans des temps où s’organise un monde qui n’est peut-être plus le nôtre, mais qu’il faut connaître pour mieux en comprendre la continuité. L’auteur s’y emploie en débordant l’histoire pour toucher des domaines aussi divers que la géopolitique, l’économie, le social, la théologie, la culture… Quelques exemples parmi d’autres :
La forme d’un pouvoir autocratique dans la Russie de toujours (même sous le communisme et avec Poutine,) est-elle fondamentalement différente de celle de Byzance ?
Erdogan, dans la Turquie d’aujourd’hui, ne s’achemine-t-il pas vers une forme de pouvoir byzantin, à la mode sultan, l’universalisme en moins ?
L’universalisme revendiqué n’est-il pas source de conflits quand il en rencontre un autre, qu’il soit chrétien (vieux rêve de chrétienté…) ou musulman (les adeptes de la charia et du califat…) ?
L’utilisation de la religion, l’instrumentalisation du sacré d’un dieu, quel qu’il soit, n’est-ce pas encore la réalité de tout pouvoir qui tente d’écraser l’homme ?
Et dans le domaine théologique chrétien, n’en finit-on pas de s’interroger sur l’Homme-Dieu Jésus ?
Alors : « Pourquoi Byzance ? » Simplement pour mieux décrypter le paysage qui se profile en arrière-plan de beaucoup des conceptions religieuses, politiques, géopolitiques et culturelles qui sont encore les nôtres.
Et pour qui s’intéresse davantage au Proche-Orient, théâtre des premiers pas du christianisme et des nombreux conflits actuels, sur des terres autrefois byzantines, voilà un livre, passionnant de bout en bout, susceptible d’éclairer d’un jour nouveau une région aujourd’hui en plein bouleversement.
Claude Popin
[1] Michel Kaplan était l’invité d’Emmanuel Laurentin, le 09/05/ 2016 : on pourra écouter 4 émissions de La Fabrique de l’histoire (France Culture) sur la Prise de Constantinople : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/prise-de-constantinople-14-actualites-des-parutions-achille