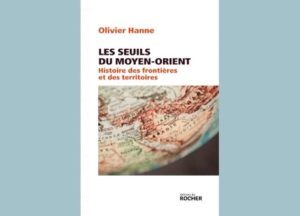Titre
Les seuils du Moyen-OrientSous titre
Histoire des frontières et des territoiresAuteur
Olivier HanneType
livreEditeur
Monaco : Éditions du Rocher, 2019Nombre de pages
538 p.-[92] p. de pl. dont 68 cartesPrix
26 €Date de publication
28 août 2022Les Seuils du Moyen-Orient : histoire des frontières et des territoires de l’Antiquité à nos jours
Nous avons là un ouvrage de référence, qui se veut un instrument de compréhension au service des chercheurs comme des politiques. Son projet n’est rien moins qu’une présentation d’ensemble de ce que l’auteur se justifie d’appeler le Moyen-Orient, depuis les origines de l’histoire jusqu’à nos jours. Son propos n’est limité que par l’angle qu’il prend, celui “des frontières et des territoires”, faisant de l’ouvrage un croisement significatif de la géographie et de l’histoire. Mais frontières et territoires renvoient à des groupes humains, et c’est l’ensemble de la réalité sociale qui se trouve ainsi évoqué, incluant les organisations politiques, religieuses et la dimension de l’économie, projetées à chaque époque sur la cartographie.
L’introduction, “L’invention du Moyen-Orient”, rend compte de ce que l’auteur met dans ce terme, sur les bornes duquel les historiens et politistes ne s’accordent pas. Et il définit (p.14) la distinction des frontières et des seuils qui va être la clé de sa présentation. La frontière est une réalité politique et militaire, le seuil est le sol que l’on parcourt pour passer d’une communauté à l’autre, passage entre le semblable et l’étranger, avec ce que cela comporte d’imaginaire. “Derrière l’idée de seuil respire la culture” (p.15). La diversité des traits géographiques fait qu’on ne peut y poser des frontières dites naturelles, seule une certaine aridité est un caractère commun aux territoires qu’il considère. Une histoire de leur cartographie est esquissée, avec le désir d’y découvrir un “centre du monde”, mais “la cartographie et la géographie de la région ont toujours été capricieuses” (p.47). Voulant enraciner l’étude des “relations internationales et des rapports de force” du présent dans la longue durée l’auteur dresse la liste des Etats actuels qu’il va considérer, l’ancien Levant auquel il adjoint l’Egypte, la Turquie et l’Iran.
Passons rapidement sur le découpage historique, cependant significatif, que propose l’auteur. Le ch.1, “L’enfance des marges”, 4ème millénaire-7e siècle av. J.C., traite de l’émergence de la cité et des premiers États. Le ch.2, “Entre Occident et Orient, le dualisme impérial”, 6e siècle av. J.C.- 6e siècle ap. J.C., décrit l’émergence perse, puis hellénique, et le dualisme des empires, Rome affrontée aux Parthes et Byzance aux Perses sassanides.
“L’unification islamique”, détaillée au ch.3, se révèle “un mirage”, entre califat et émirats, jusqu’à ce que la “tornade mongole”, une fois passé l’épisode des Croisades, aboutisse au règne des Mameluks et des Ottomans (7e-15e siècles).
Ce sont les chapitres 4 et 5 qui sont les plus parlants pour qui s’intéresse à la vie actuelle de ces peuples et de ces États. Le ch.4, “Des Ottomans à la captation européenne”, rapporte la montée en puissance de l’empire ottoman dans la région, du 16ème au 18ème siècle, puis son déclin du fait de la “captation” européenne, et l’auteur dit aussi “l’enlèvement par l’Europe”. C’est dire à quel point le dépérissement puis la disparition totale, en 1921, de l’empire ottoman sont liés à une pression européenne continue. On pourrait la rapprocher du mouvement antérieur de reconquista sur l’Espagne musulmane des monarchies ibériques. Enfin le ch.5, “Les bornes de l’État-nation”, expose le cadre que le Moyen-Orient s’est vu imposer après la Première guerre mondiale, celui de l’État-nation, dont le principe a présidé aux traités dictés par les vainqueurs aux vaincus de la guerre. Après le régime des mandats, les indépendances ont vu se fixer des territoires, qui devenaient lourdement dépendants des enjeux mondiaux. Sont ainsi détaillés le surgissement d’Israël, les répercussions locales de la Guerre froide, le nassérisme et les mouvements panarabes, jusqu’à la guerre Iran-Irak des années 1980. Depuis 1991, de l’islamisme au djihadisme, de la Pax americana au retrait américain, des sociétés “enfermées dans leurs frontières” y sont plus ou moins en proie au chaos. Y a-t-il l’espoir qu’il soit “réparateur” ?
La conclusion au titre savant, “Horogenèse et seuils”, revient en fait sur la notion de “seuil” en lui donnant ses multiples dimensions liées aux types de frontières différentes qu’a connues le Moyen-Orient à travers les âges et qu’il connaît encore, dans des fidélités croisées qui n’ont pas d’ordre hiérarchique. Là est peut-être sa chance.
Dans cet ouvrage de référence, on trouve, puisqu’il s’agit de frontières, une abondance de cartes et schémas, une bibliographie fournie et des index des lieux, des peuples et des personnes. Un outil précieux pour quiconque s’intéresse à cette région. Son érudition n’empêche pas une lecture facile.
Jean-B. Jolly
Membre du bureau de CDM