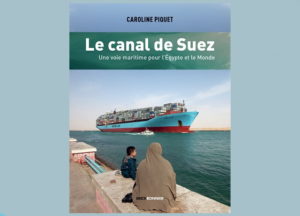Titre
Le Canal de SuezSous titre
Une voie maritime pour l’Égypte et le MondeAuteur
Caroline PiquetType
livreEditeur
Paris : Erick Bonnier, 2018Collection
Collection : Encre d’OrientNombre de pages
470 p.Prix
22 €Date de publication
4 décembre 2019Le Canal de Suez. Une voie maritime pour l’Égypte et le Monde
A l’approche du 150ème anniversaire de l’inauguration du Canal de Suez, le 17 novembre 1869, l’Institut du Monde Arabe de Paris avait organisé une exposition au printemps 2018[1]. Une occasion saisie par une petite maison d’édition pour offrir à un public visiblement intéressé la réimpression de L’Histoire du Canal de Suez, épuisée, parue chez Perrin en 2009.
Cette nouvelle parution de l’ouvrage de Caroline Piquet comporte, non seulement une introduction de réactualisation, mais un important chapitre final concernant les dix dernières années écoulées, car l’histoire s’est accélérée, tant du point de vue technique que politique. En août 2015, une inauguration de gigantesques nouveaux aménagements a remis en lumière l’importance de cette voie d’eau dans le contexte de la mondialisation dominante.
Caroline Piquet enseigne à la Sorbonne. Elle est spécialiste de l’histoire économique et sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Son Histoire du Canal de Suez est remarquable de précisions techniques sur la réalisation, rêvée depuis l’Antiquité, de cette entreprise pharaonique et son évolution, que ce soit le creusement à main nue des premiers fellahs égyptiens astreints à la corvée jusqu’aux gigantesques dragueuses d’aujourd’hui, ou les dimensions sans cesse augmentées, passant de 8 mètres de profondeur à 24 mètres, des capacités de tonnage des navires allant de 5000 en 1870 à 240000 en 2015, des 44 mètres de largeur de la voie d’eau initiale aux 225 mètres d’aujourd’hui…
En filigrane, derrière cette réalisation du canal, se dessine une autre histoire : celle de l’évolution de la marine marchande mondiale, la spécialisation des bateaux (vraquiers, pétroliers, porte-conteneurs…) l’accroissement des vitesses, la diversification des propulsions, etc. Au passage, le lecteur prendra un cours de navigation sur le canal, avec l’importance des balises, le rôle irremplaçable des pilotes, les formations en convois, les vitesses à respecter, l’art d’aborder les courbes ou les espaces de croisement avec des navires dépassant parfois les 300 mètres de long. Jalonnant le texte, des tableaux chiffrés renseignent sur toutes les transactions économiques, en nombre de passagers ou de marchandises et en pourcentages d’utilisation par pays.
Tout cela (et bien d’autres choses encore…) pourrait paraître anecdotique si l’on esquivait la « philosophie » de l’entreprise. Or, Caroline Piquet excelle à décrypter les intentions et les évolutions sociales et géopolitiques qui entourent cette réalisation qui nous paraît banale aujourd’hui. Conçu dans l’essor économique et la révolution industrielle de l’Europe du XIXe siècle, le canal est d’abord apparu comme un progrès de l’humanité. Inspirée par les saint-simoniens, l’utopie du Français Ferdinand de Lesseps (1805-1894) était de faire œuvre universelle, en sollicitant des capitaux de toutes les nations appelées à commercer entre elles. Seule, l’Angleterre s’y refusera d’abord, ce qui ne l’empêchera pas (ironie de l’histoire !) d’en être bientôt la principale utilisatrice (la route des Indes…).
Or, l’accroissement du commerce et des biens manufacturés s’est accompagné de la nécessité de trouver des matières premières et d’écouler les productions. La colonisation des peuples d’Asie et d’Afrique a été la première bénéficiaire de l’ouverture du canal de Suez. La « légende dorée » de l’œuvre humanitaire européenne s’est vite heurtée à la « légende noire » des peuples colonisés. Et d’abord, au principal intéressé : l’Égypte, sur lequel il était implanté. « Suez » va cristalliser les ressentiments contre un Occident apparaissant de plus en plus comme oppresseur et spoliateur, et c’est dans la mouvance de la décolonisation des années d’après la seconde guerre mondiale qu’il faut situer la nationalisation du Canal de Suez en 1956 avec Nasser.
On est donc passé des perspectives techniques et économiques à des considérations politiques. Et c’est tout le sens du dernier chapitre de la présente édition, un rajout de l’auteur qui insiste sur le symbole que représente le « nouveau canal de Suez » pour l’Égypte. Non seulement, c’est une réappropriation, mais, pour le nouveau chef de l’État, le maréchal Sissi, c’est faire que l’Égypte tienne toute sa place dans la mondialisation du XXIe siècle. Un geste qui sert autant la politique intérieure que la géopolitique dans une région loin d’être apaisée.
On aura noté la différence des titres entre les deux publications. Cette réimpression n’est plus seulement L’Histoire du Canal de Suez, mais un canal à finalité politique « pour l’Égypte et le Monde ». 150 ans après sa première inauguration, cette « voie d’eau » internationale, pour ne pas dire « universelle », est bien une réalité avec laquelle le monde doit compter.
L’abondance des notes de la première édition, utile aux historiens, ne se retrouve pas ici : le texte s’en trouve allégé pour le grand public. Qu’il soit simplement permis de regretter la portion congrue réservée à la cartographie et aux illustrations, et quelques coquilles… qui n’enlèvent rien à l’excellence du fond…
Claude Popin
[1] 17 novembre 2019 : 150e anniversaire de l’inauguration du Canal de Suez. On pourra écouter la balade radiophonique de l’exposition sur L’épopée du Canal de Suez dans l’émission La Fabrique de l’Histoire d’Emmanuel Laurentin, le 28/03/2018, avec plusieurs intervenants dont Caroline Piquet (durée : 51 mn)