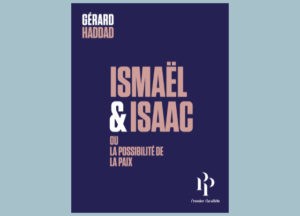Titre
Ismaël et Isaac ou la possibilité de la paixAuteur
Gérard HaddadType
livreEditeur
Paris : Premier Parallèle, 11/10/2018Nombre de pages
148 p.Prix
14€Date de publication
26 novembre 2018Ismaël et Isaac ou la possibilité de la paix
De Caïn et Abel à Joseph et ses frères, la question de la difficile cohabitation fraternelle traverse tout le récit de la Genèse. Gérard Haddad envisage le couple fraternel d’Ismaël et Isaac à partir du « complexe de Caïn[1] », dont il fait une topique complémentaire du complexe d’Œdipe freudien. Il propose de lire, avec ce filtre, le conflit entre le monde arabo-islamique et l’occident en actualisant ce récit.
Gérard Haddad, né en 1940 à Tunis, est ingénieur agronome, psychiatre et psychanalyste. En 1969 il entame avec Jacques Lacan une psychanalyse qui le conduit à retrouver son judaïsme, et à étudier ses textes fondateurs en lecture croisée avec la psychanalyse.
Son analyse de la dynamique du couple fraternel Ismaël-Isaac s’appuie sur le verset 62 du chapitre 24 de la Genèse : « Or, Isaac revenait de visiter la source du ‘Vivant qui me voit ’ ». Il s’agit de la première rencontre entre Isaac et Rebecca. Ce puits, pour Gérard Haddad est le pivot de la relation entre Ismaël et Isaac. Agar et son fils, Ismaël, encore tout jeune enfant, s’y refugièrent. Le midrash[2] ajoute qu’Isaac y était allé pour ramener Keturah – qui n’est autre qu’Agar -, auprès de son père esseulé après la mort de Sara (Gn 23, 2), ainsi qu’Ismaël et sa descendance. Les versets 8 et 9 du chapitre 25 : « Abraham mourut, dans une heureuse vieillesse, et il rejoignit ses pères. Il fut inhumé par Isaac et Ismaël, ses fils, dans le caveau de Makhpela » permettent à Gérard Haddad, à la suite de la tradition midrashique, de conclure que, finalement, Ismaël et Isaac s’installèrent dans un « paisible voisinage » (p. 47- 49). Paisible voisinage, hélas, perdu de nos jours « dans l’épouvantable atmosphère qui empoisonne aujourd’hui les relations entre les descendants des deux patriarches » (p.46) et où les descendants d’Ismaël se sentent exclus du monde occidental (p. 78, 85).
Exclus sémantiquement, puisqu’on parle de « civilisation judéo-chrétienne ». L’auteur propose de lui substituer la nomination de « civilisation gréco-abrahamique » dans laquelle « l’islam serait légitime à se reconnaître » (p. 101, 146). Mais aussi exclus matériellement et intellectuellement alors qu’ils furent à la pointe des sciences et de la culture du temps des Almoravides de Cordoue et de Grenade. Mais les Almohades, venu du Maroc, imposèrent un islam fanatique et intransigeant, fermant les portes de « l’Ijtihad » c’est-à-dire de la pensée critique.
La rupture consommée entre le monde islamique et le monde occidental va, selon l’auteur, jeter les descendants d’Ismaël et d’Isaac dans un rejet névrotique mutuel de leur complémentarité. L’isolement de l’islam ne lui permettra pas d’être touché par deux révolutions qui vont permettre la suprématie de l’occident : la révolution scientifique et la transformation du statut de la femme (p. 103).
Dans la dernière partie de l’ouvrage, Gérard Haddad souligne, à juste titre, le caractère instable de cette société. Instabilité contrebattue par le radicalisme islamique tyrannique, ou par la dictature militaire. Il attribue cette instabilité structurelle au fait que cette société se fonde sur « la fraternité ». Fraternité certes « attractive mais éminemment fragile, ne pouvant se fonder que sur une rivalité initiale refoulée » (p.135). Ce refoulement ne peut se maintenir que par « l’intervention d’une instance tierce, celle du ‘père’ qui énonce la loi de l’interdit du meurtre du frère » (p.135-136). Instance tierce qui n’existe pratiquement pas dans le monde arabo-musulman : elle ne peut se présenter que sous la forme d’une Constitution démocratique.
Mais la démocratie ne peut se réaliser « qu’au prix d’une séparation du religieux et du politique – en renvoyant le Coran à la sphère privée[3] -, d’une indépendance du discours scientifique et du changement du statut de la femme » (p. 141, 147-148). Bref il s’agit de « rouvrir les portes de l’Ijtihad[4] » c’est-à-dire « les portes de la pensée critique qui accompagna l’essor de cette foi. » (p. 66, 98).
En conclusion, Gérard Haddad [5] demande aux juifs et aux musulmans de « se souvenir du pacte tacite qui liait Isaac et Ismaël et de pratiquer « un dialogue raisonné […] dont l’objectif est de restaurer les conditions de bon voisinage qu’ont pratiqué [leurs] deux ancêtres et de retrouver la fraîcheur de la ‘source du Vivant qui me voit’ » […] « Le bon voisinage, voilà l’essentiel. Si Isaac et Ismaël y sont parvenus, pourquoi leurs descendants ne le pourraient-ils pas, dans un échange de bienfaits nécessaires et utiles aux deux, sous le regard jaloux du Vivant ? » (p. 147, 59).
Daniel Ollivier[6]
[1] Cf. Autres livres de G. Haddad sur la violence humaine, édités par Premier Parallèle :
Le Complexe de Caïn : Terrorisme, haine de l’autre et rivalité fraternelle éd. le 05/01/2017 et
Dans la main droite de Dieu : Psychanalyse du fanatisme éd. le 05/09/2015
[2] Qu’est-ce que le midrash ?
[3] A laquelle ont été renvoyés également la Torah et les Évangiles pour le judaïsme et le christianisme (p.147).
[4] Cf. Musulmans contre l’islam ? : rouvrir les portes de l’Ijtihad / Hechmi Dhaoui et Gérard Haddad.- Cerf, 2006.- (L’Histoire à vif)
[5] A propos de son livre, on pourra écouter Gérard Haddad invité de l’émission Talmudiques, sur France Culture, le 28/10/2018 (durée : 32 mn) et de l’émission Le temps de le dire, sur RCF, le 13/11/2018 (durée : 55 mn) avec Ghaleb Bencheikh et Henry Fautrad, sur : Fanatisme et religion : comment combattre la violence ?
[6] Daniel Ollivier est diplômé d’hébreu biblique ; collaborateur du Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme (CCEJ) de la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon ; et membre du Cercle de la Pensée Juive Libérale de Lyon. (CPJL).