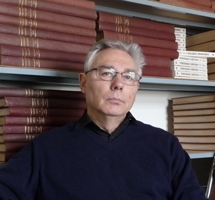 Leur vie, leur mort, quels messages pour aujourd’hui ?
Leur vie, leur mort, quels messages pour aujourd’hui ?
Par le père Bernard Janicot du diocèse d’Oran qui interviendra t le samedi 4 février 2012 dans le cadre de la matinée d’Etude organisée par les amis du CDES d’Oran sur le thème : 50 ans d’indépendance de l’ALGERIE, comment ont évolué la société algérienne et ses représentations politiques (de 9 h à 13 h au Centre d’études ISTINA, 45 rue de la Glacière , 75013 PARIS). Chrétiens de la Méditerranée communiquera prochainement sur les interventions du père Janicot lors de son passage en France fin janvier-début février.
Morts à quelques mois d’intervalle, dans cette période particulièrement violente que fut l’année 1996 en Algérie, Pierre Claverie, et Christian de Chergé, l’un père dominicain nommé évêque d’Oran en 1981, pasteur d’un diocèse certes modeste, mais tout de même bien vivant, l’autre moine trappiste puis prieur de la communauté Notre-Dame de l’Atlas, près de Médéa, se connaissaient bien, s’appréciaient, se critiquaient aussi parfois.
Le monastère de Tibhirine – « le jardin » – est devenu célèbre, à son corps défendant, depuis la mort de sept de ses neuf moines et la publication presque immédiate du « Testament spirituel » de Frère Christian, mais le monastère était quasi inconnu en Algérie, hors de la communauté chrétienne, jusqu’aux tristes événements de Mai 1996. Le film « Des hommes et des dieux » ou le DVD « le Testament de Tibighine », ont permis à un large public de découvrir l’existence de ces moines en milieu musulman algérien.
Pierre Claverie est né le 8 Mai 1938 à Bab el Oued, quartier populaire d’Alger, de parents pieds-noirs depuis quatre générations. Il fréquente assidûment dans sa jeunesse la troupe des scouts dominicains d’Alger. En 1957, à 19 ans, il rejoint la métropole pour faire des études d’ingénieur, avant d’entrer fin 58 chez les Dominicains. C’est là que ses yeux vont s’ouvrir sur la réalité de l’Algérie, de la jeunesse qu’il y a vécu, et tout particulièrement de cette « bulle coloniale » dans laquelle il était enfermé et dont il parlera ensuite souvent. Il élargira même le concept à la « bulle catholique », la « bulle chrétienne », voire « la bulle occidentale ». Ordonné prêtre en 65, il rejoint en 67, selon son souhait, le couvent dominicain d’Alger, et il devient directeur du Centre des Glycines. Nommé Evêque d’Oran en 81, il remplace Mgr Henri Teissier, lui-même nommé archevêque d’Alger. Il exercera sa charge jusqu’au 1er Août 1996, date de son assassinat dans son évêché, de retour d’un voyage à Alger.
Christian de Chergé est né à Colmar en 1937 dans une famille de militaires, ce qui l’amène à passer une partie de son enfance à Alger où son père est commandant. Il entre au séminaire des Carmes, à Paris, en 1956, et fera son service militaire en Algérie, où un musulman, garde-champêtre va lui sauver la vie. Moment éminemment important dans le cheminement spirituel de Christian. Il est ordonné prêtre en 1964 au séminaire des Carmes à Paris, et sera pendant trois ans chapelain au Sacré Cœur de Montmartre. Il s’oriente quelques années plus tard vers les Trappistes, et il choisit en 1969 d’entrer au monastère de Tibhirine où il arrive en 71. Il étudie la langue et la culture arabe, en plus du latin, du grec et de l’hébreu qui avaient fait partie de son cursus universitaire aux Carmes. Il devient prieur de « Notre Dame de l’Atlas » en 1984 et le sera jusqu’à sa mort en Mai 1996.
Deux itinéraires somme toute assez proches, ils sont nés à un an d’intervalle, ont tous deux connus l’Algérie au cours de leur jeunesse, ont choisi, l’un et l’autre de revenir en Algérie à deux ans d’intervalle…et sont morts assassinés à quels mois l’un de l’autre.
Deux personnes qui, bien que très différentes dans leurs tempéraments, que bien des aspects rapprochent aussi. Ce sont surtout ces similitudes, ces parallélismes parfois assez étonnants que je voudrais mettre en lumière.
Un « passé fondateur » en Algérie –
Cette « alliance » avec l’Algérie et les algériens, qui marquera la vie de Pierre Claverie date de son enfance à Bab El Oued et sa prise de conscience quand il avait une vingtaine d’année de « la bulle » dans laquelle il vivait. Il vit alors une véritable « conversion », un vrai retournement.
« J’ai vécu dans une bulle, ignorant l’autre, ne rencontrant l’autre que comme faisant partie du paysage ou du décor…Un jour il m’a sauté à la figure. Il a fait exploser mon univers clos… Il a affirmé son existence. L’émergence de l’autre, l’ajustement à l’autre sont devenus des hantises… Je me suis dit : désormais, plus de murs, plus de frontières, plus de fractures. Il faut que l’autre existe, sans quoi nous nous exposons à la violence, à l’exclusion, au rejet… Découvrir l’autre, vivre avec l’autre, entendre l’autre, se laisser façonner par l’autre, cela ne veut pas dire perdre son identité, rejeter ses valeurs, cela veut dire concevoir une humanité plurielle, non exclusive. »
Pour Christian, l’événement fondateur est plus lourd encore et réside dans le fait que pendant son service militaire, il ait eu la vie sauve grâce à un ami algérien, Mohamed, qui lui, sera assassiné à la place de Christian. « Dans le sang de cet ami, j’ai su que mon appel à suivre le Christ devrait trouver à se vivre, tôt ou tard, dans le pays même où m’avait été donné le gage de l’amour le plus grand. »
Dans un cas comme dans l’autre, l’attachement à l’Algérie, aux algériens musulmans, comporte à l’origine, à la racine une dimension très « viscérale ». Cet attachement sera ensuite longuement mûri et réfléchi, au long de leur vie dans ce pays où l’un et l’autre, devenus adultes, religieux, prêtres, ont choisi de revenir.
Un attachement aux algériens musulmans –
Cet attachement va se concrétiser dans un commun désir d’entrer en relation avec les musulmans, la culture arabe, l’Islam… avec des conceptions finalement assez proches du « dialogue islamo-chrétien ». L’un et l’autre partagent une conviction forte : celle qui consiste à croire que dans ces relations se joue quelque chose d’important pour l’Eglise, à l’évidence, mais aussi pour le monde, sachant que nous vivons désormais partout ou presque dans des sociétés plurielles, culturellement, religieusement. Et que cette réalité, même si elle est parfois plus difficile à vivre, est très probablement une chance pour nos sociétés.
L’un développera cette conviction à partir et dans sa vie monastique, l’autre dans sa vie de père dominicain puis de pasteur, évêque d’Oran.
Mais, pour le moine comme pour l’évêque, c’est dans la vie quotidienne que tout commence, et que, d’une certaine façon, tout se joue.
Le film « Des hommes et des dieux » de Beauvois met bien en valeur cet aspect de la vie des moines de Tibhirine. Au dispensaire du Frère Luc, médecin, comme dans les cours de soutien que pouvait donner l’un ou l’autre à des enfants du quartier, dans le travail agricole fait en commun avec des associés algériens sur le domaine et dans les jardins du monastère ou encore dans les visites accomplies dans le quartier, moines et voisins se retrouvaient et partageaient, échangeaient sur la vie quotidienne, vivaient tout proches les uns des autres. Et cette existence partagée au jour le jour nourrissait la prière monastique. J’ai été souvent le témoin de ces prières où étaient cité telle ou telle personne du voisinage traversant une situation difficile, un décès, une maladie, un jeune au chômage…
Pierre Claverie, d’une manière différente, vivait lui aussi intensément son quotidien. Il avait de multiples réseaux de relations ; dans les milieux intellectuels ou juridiques, mais aussi parmi les gens les plus modestes, les plus simples. Cela apparaîtra avec force lors de ses obsèques auxquelles participèrent des personnes de toutes sortes, du ministre au gardien de voitures, ou du « 40ème jour » où de très nombreuses personnes du quartier, épicier, coiffeur, voisins voulurent être présents, ayant conscience de perdre l’un des leurs.
Il exprimait bien cette conviction dans un texte reproduit dans « Humanité plurielle » :
« Le dialogue islamo-chrétien commence alors dans la vie quotidienne, dans les relations de voisinage, de services et d’amitié parfois, qui s’établissent avec le temps et peuvent faire naître des sentiments d’estime et de respect réciproques, non pour une idée de l’islam, même flatteuse, mais pour des musulmans et des musulmanes concrets que leur religion inspire dans la diversité de leurs cultures, de leur tempérament et de leur choix. Dans la relation sociale et professionnelle, des collaborations et des luttes communes pour la liberté, la justice et la paix, pour un monde plus humain, contribuent certainement à renforcer la communication et la communion. Alors viennent les questions sans lesquels le dialogue ne serait qu’un double monologue ou « dialogue de sourds. » Car, avec l’expérience d’une vie ensemble, naissent les mots pour dire les réalités partagées. L’échange sur les raisons de vivre devient possible sans qu’il paraisse incongru ou prosélyte. Le dialogue devient ainsi religieux à condition que le respect de l’autre soit associé à un souci de vérité et qu’à aucun moment on ne travestisse ses convictions pour les rendre plus acceptables. Si la relation est sincère, cette exigence de vérité va de soi et constitue le fondement même du respect que l’on a envers l’interlocuteur. On ne construit rien sur le mensonge, la peur de déplaire et les demi- vérités. »
« A t-on finit de lancer partout contre la différence des anathèmes ? Mieux vaut tenter de rejoindre ensemble le no man’s land de l’existence concrète, là-même où nous nous croyons convoqués, les uns et les autres, à l’adoration de l’Unique comme au partage avec tous. Entre gens simples et de bonne foi, la différence y prend un contour plus familier ; elle fait corps avec la vie et s’intègre dans les rapports mutuels, à longueur du quotidien. Elle prend un visage ami qui a bien des traits divins. Elle inspire le respect des voies de Dieu et du cœur de l’homme. Elle peut trouver sa calme place dans la prière, voire même, ici ou là, dans la prière en commun : Dieu est plus grand ! Le cœur lui-même à ses raisons … » pouvait écrire Christian de Chergé.
Parlant de la pensée de Frère Christian, Christian Salenson écrit : « Le dialogue interreligieux est l’expression consacrée pour désigner les relations entre personnes de traditions religieuses différentes et à travers elles entre les religions elles-mêmes. En aucun cas il ne se réduit au dialogue sur la religion des uns et des autres. Il concerne l’ensemble de la vie. Inversement, il ne passe pas sous silence la foi des uns et des autres. Le dialogue avec des amis musulmans ou des voisins, même s’il prend la forme concrète de relations interpersonnelles, ne saurait s’y réduire. Il est appelé à s’ouvrir sur la considération positive de la tradition religieuse de l’autre. »
Cette relation, pour être vraie exige, et l’un et l’autre l’ont non seulement compris, mais vécu, la pauvreté du cœur, mais aussi la pauvreté matérielle. Celle qui rend proche de ceux et celles qui nous entourent, de ceux et celles que l’on reçoit, que l’on rencontre.
Il se racontait sur le diocèse d’Oran une anecdote significative. Quand Pierre Claverie a été nommé évêque d’Oran et qu’il vint s’installer dans son nouvel évêché, il arriva avec deux valises. Et, à la personne qui lui demandait quand il pensait recevoir le reste de son déménagement, il répondit simplement : mais, tout est là.
Pauvreté encore plus sensible à Tibhirine où les moines trappistes, déjà pauvres par « nature », l’étaient encore plus qu’ailleurs.
Pauvreté matérielle, mais aussi pauvreté spirituelle ou humilité marquait profondément l’un et l’autre. Leurs écrits s’en font l’écho ; ils correspondent bien à leurs vies :
« Dans le dialogue et la rencontre, il est extrêmement important de croire que je ne suis pas meilleur que l’autre, plus fort que l’autre, plus savant… que simplement, je suis autre et nous tenons notre valeur, l’un et l’autre, de la parole d’amour qui nous fait être maintenant chacun…Nous devenons communicants par nos côtés les plus fragiles. Le problème est que nous cherchons toujours à blinder ces côtés-là » écrivait Pierre.
Christian insiste souvent, lui aussi, sur l’humilité : « Il faudrait toujours commencer tout dialogue entre croyants de bonne foi : convenir ensemble que Dieu nous appelle ensemble à l’humilité. C’est renoncer logiquement à se prétendre meilleurs ou supérieurs ; c’est aussi tendre vers une forme d’authenticité personnelle sans laquelle nous ne saurions rêver de prétendre à la vérité. »
Réflexion à laquelle celle de Pierre Claverie pourrait faire écho : « Non seulement j’admets que l’autre est autre, sujet dans sa différence, libre dans sa conscience, mais j’accepte qu’il peut détenir une part de vérité qui me manque et sans laquelle ma propre quête de vérité ne peut aboutir totalement. J’ai besoin de lui carrément à ma connaissance. L’autre peut donc m’apporter quelque chose d’essentiel. »
Cette rencontre de l’autre, qui prend sa source dans la vie quotidienne, se poursuit, chez l’un et l’autre, dans une réflexion spirituelle voire théologique. Car aussi bien Pierre Claverie que Christian de Chergé ont une conscience aigue que ce qui se passe-là, dans cette vie relationnelle avec les algériens musulmans, est une Parole pour les croyants qu’ils sont.
Cette rencontre est le lieu d’une « révélation », dans laquelle Dieu dit quelque chose. Quelque chose d’essentiel. « Le dialogue est le moyen principal de la révélation : l’essentiel n’est pas ce qu’on fait, mais par ce qu’on fait, d’ouvrir le dialogue. »
Christian de Chergé insiste beaucoup sur la miséricorde à accueillir, prenant en considération un attribut commun aux chrétiens et aux musulmans concernant Dieu.
Il écrivait ainsi en 1983 « Le monde serait moins désert si nous pouvions nous reconnaître une vocation commune, celle de multiplier au passage les fontaines de miséricorde. Et comment douter de cette vocation commune si nous laissons le Tout Miséricordieux nous appeler ensemble à une table unique, celle des pécheurs. »
« Chrétiens et musulmans, nous avons un besoin urgent d’entrer dans la miséricorde mutuelle. Une parole commune qui nous vient de Dieu nous y invite. C’est bien la richesse de sa miséricorde qui se manifeste lorsque nous entrons modestement dans le besoin de ce que la foi de l’autre nous en dit, et mieux encore, de ce qu’il en vit. Cet exode vers l’autre ne saurait nous détourner de la Terre Promise, s’il est bien vrai que nos chemins convergent quand une même soif nous attire au même puits. Pouvons-nous nous abreuver mutuellement ? C’est au goût de l’eau qu’on en juge. La véritable eau vive est celle que nul ne peut faire jaillir, ni contenir. Le monde serait moins désert si nous pouvions nous reconnaître une vocation commune, celle de multiplier au passage les fontaines de miséricorde. Et comment douter de cette vocation commune si nous laissons le Tout-Miséricordieux nous appeler ensemble à une table unique, celle des pécheurs ? »
Dans une période plus difficile, Pierre Claverie, conscient de ses responsabilités d’évêque écrivait : « Plus que jamais le dialogue est nécessaire et nous devons TOUT faire pour le sauvegarder et le promouvoir. La coexistence implique une connaissance vraie, objective et exigeante. Mais elle est aussi un rapport de force qu’il faut sans cesse négocier sous peine de le voir dégénérer en oppression, en exclusion et en violence. Je pense que nous allons traverser des heures difficiles. Notre église est un des lieux où la négociation demeure possible entre les personnes et les groupes humains. Nous n’entretenons aucune ambition de pouvoir ou d’expansion. Nous voulons seulement aider à rendre possible une cohabitation dans la différence et non seulement au-delà des différences. Cohabitation qui respecte toutes les diversités et prennent le risque de leur donner une place et un rôle. Cohabitation qui se fonde, enfin, sur une volonté obstinée de vivre ensemble. »
Ce à quoi Christian aurait pu ajouter : « Voir les choses différemment ne signifie pas qu’on ne voit pas les mêmes choses ; dire Dieu autrement n’est pas dire un autre Dieu. »
Car ce désir de rencontrer l’autre ne peut être vrai que s’il s’accomplit dans la vérité ; Le désir de rencontrer l’autre tel qu’il est, dans sa vérité, et donc d’accepter les différences.
Dans un texte souvent cité, Pierre Claverie affirmait : « J’acquiers la conviction personnelle qu’il n’y a d’humanité que plurielle et que, dès que nous prétendons posséder la vérité ou parler au nom de l’humanité, nous tombons dans le totalitarisme et dans l’exclusion. Nul ne possède la vérité, chacun la recherche, il y a certainement des vérités objectives mais qui nous dépassent tous et auxquelles on ne peut accéder que dans un long cheminement et en recomposant peu à peu cette vérité-là, en glanant dans les autres cultures, dans les autres types d’humanité, ce que les autres aussi ont acquis, ont cherché dans leur propre cheminement vers la vérité…. On ne possède pas Dieu. On ne possède pas la vérité et j’ai besoin de la vérité des autres. »
Dans un langage plus théologique, Christian Salenson, méditant l’œuvre de Christian de Chergé peut ajouter : « S’il nous est permis d’avoir une mystique de la différence, c’est bien parce que celle ci s’origine en Dieu même … Elle s’exprime en clair dans un dialogue où le Verbe reste unique quand il murmure : Mon Père… Mon Fils ! L’Esprit seul peut faire la différence. Il est le lien par excellence. Il garantit personnellement l’union parfaite dans la sauvegarde des Personnes : une union sans confusion »
« Il s’agit bien d’entrer dans l’axe de l’autre, comme le voulait Massignon. L’autre me concerne. C’est en tant qu’il est autre, étranger, musulman, qu’il est mon frère. Sa différence a du sens pour moi, dans ce que je suis. Elle donne de la consistance à notre relation mutuelle, comme à notre quête commune d’une unité en Dieu »
Il nous faut continuer d’affirmer que ce droit à la différence est une bonne nouvelle pour tout le monde. C’est là notre évangile ».
Bien entendu, dans cette différence, l’Islam tient une grande place. D’où la question que se posent, parmi beaucoup d’autres, l’évêque et le moine : « Quelle est la place de l’Islam dans le dessein de Dieu ? »
Question lancinante pour Christian de Chergé. Déjà en 89, il écrivait :
« Depuis trente ans que je porte en moi l’existence de l’islam comme une question lancinante, j’ai une immense curiosité pour la place qu’il tient dans le dessein de Dieu. La mort seule me fournira, je pense, la réponse attendue.
Question reprise dans son testament : « Sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s’il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler ses enfants de l’islam, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de sa passion, investis par le don de l’Esprit…
Je suis sûr de la déchiffrer (la réponse à la place de l’islam dans le dessein de Dieu), ébloui, dans la lumière pascale de Celui qui se présente à moi comme le seul musulman possible parce qu’il n’est que oui à la volonté du Père. »
De son côté, Pierre Claverie écrivait en 1990 : « Quelle place pouvons-nous faire dans notre foi, à ces religions qui se partagent les deux tiers de l’humanité et qui proposent à l’homme une approche de Dieu différente de la nôtre et une sagesse pour le monde. Nous observons… que la religion musulmane nourrit d’authentiques croyants,… des hommes et des femmes de prière, de fraternité et de paix. Nous ne pouvons plus penser simplement que nous avons l’exclusivité et la totalité de la connaissance de Dieu et que les autres sont privés de la lumière nécessaire à leur salut. Tenir cette position serait faire une injure aux desseins d’amour du Père et à la portée universelle du salut en Jésus-Christ. Mais on ne peut également penser simplement que Jésus est une figure parmi d’autres de la révélation multiforme de Dieu qui laisse place à d’autres « prophètes » équivalents et à un achèvement tel que le propose l’islam.»
L’un et l’autre portaient leurs rencontres dans la prière :
Pour Pierre, « la prière, cette mise en relation consciente et volontaire avec Dieu, est un élément essentiel de notre vie. C’est cette présence qui donne son véritable poids à nos vies, et qui fait de nos métiers, de nos travaux, de nos paroles, de nos rencontres, des actes vraiment humains. » ; il écrivait aussi : « mon rêve, tenez-vous bien, ce serait d’être trappiste quelque part et de centrer mon existence sur ce que je pressens le plus important en elle, et finalement le plus nécessaire pour les autres. »
J’ignore si Christian rêvait parfois d’être dominicain !
La communauté Notre-Dame de l’Atlas vivait tout proche d’une mosquée sise dans une dépendance du monastère, modeste salle de prière à l’époque, mosquée plus développée aujourd’hui, ce qui fait sans doute écrire à Christian :
« La prière des uns appelle la prière des autres pour converger plus loin que ce qu’on peut en dire : venant de notre cloche ou du muezzin, les appels à la prière établissent entre nous une saine émulation réciproque… Cloche et muezzin, dont les appels à la prière s’élèvent du même enclos, font cause commune pour nous convier ensemble à la louange, plus loin que ce que les mots peuvent en dire.
Et encore : « Nous nous sentons appelés à l’unité. Nous souhaitons laisser Dieu créer entre nous quelque chose de nouveau. Cela ne peut se faire que dans la prière… »
Ce qui fait dire à Christian Salenson qu’une « communauté monastique complètement insérée en terre d’islam pour creuser, explorer et signifier notre relation dans la foi et la prière avec les musulmans, est un joyau précieux pour l’Eglise. »
Une fidélité dans l’amour du pays –
Une fidélité dans l’engagement, dans l’amour du pays, des gens de ce pays : cette fidélité fut bien évidemment au cœur de la vie de Pierre comme de celles de tous les moines de Tibhirine.
Un engagement dont l’un et l’autre connaissait les risques…
Christian écrivait en 1995 :
« Il nous faut du courage et de la persévérance. Courage pour accepter l’autre tel qu’il est, là où il en est, avec ses richesses, ses limites, ses originalités, sans le rêver à la mesure de ce que nous sommes, ou de ce que nous souhaiterions qu’il soit. La confiance doit l’emporter, même s’il y a place pour le doute. »
Et Pierre Claverie dans une de ses dernières homélies – c’était chez les Dominicaines de Prouilles le 23 Juin 1996 – prononçaient des phrases fortes maintes fois reproduites depuis :
« Depuis le début du drame algérien, on m’a souvent demandé : Que faites-vous là-bas ? Pourquoi êtes-vous restés ? Secouez donc la poussière de vos sandales ! Rentrez chez vous ! Chez vous ? Où sommes-nous chez nous ? Nous sommes là-bas à cause de ce Messie crucifié. A cause de rien d’autre et de personne d’autre ! Nous n’avons aucun intérêt à sauver, aucune influence à maintenir. Nous ne sommes pas poussés par je ne sais quelle perversion masochiste ou suicidaire. Nous n’avons aucun pouvoir, mais nous sommes là comme au chevet d’un ami malade, d’un frère malade, en silence, en lui serrant la main, en lui épongeant le front. A cause de Jésus parce que c’est lui qui souffre là, dans cette violence qui n’épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de milliers d’innocents. Comme Marie sa mère et Saint Jean, nous sommes là, au pied de la croix où Jésus meurt, abandonné des siens et raillé par la foule. N’est-il pas essentiel pour le chrétien d’être présent dans ces lieux de souffrance, dans les lieux de déréliction, d’abandon. »
Il écrivait ailleurs : « la parabole du grain de blé qui meurt est l’axe central de toute ma vie chrétienne. »
Engagement par la prise de parole, y compris parfois la parole publique, une parole risquée, mais qui lui paraissait nécessaire.
Engagement par le simple fait de rester, alors que tout le monde ou presque conseillait de partir….
Leur mort, un martyr ?
La question demeure posée….
Le frère Michel, autre moine de Notre de l’Atlas de Tibighine, écrivait en Mai 1994 :
« Martyr, c’est un mot tellement ambigu ici… S’il nous arrive quelque chose – je ne le souhaite pas – nous voulons le vivre, ici, en solidarité avec tous ces Algériens et Algériennes qui ont déjà payé de leur vie, seulement solidaires de tous ces inconnus, innocents. »
Christian Salenson écrit en citant ensuite Chergé : « Pour les moines, cet amour prit la forme de la fidélité à un peuple, à leurs voisins, à leurs amis, à leur Eglise et les conduisit au don total de leur vie. En cela, leur martyre s’inscrit dans celui de Jésus qui est un martyre d’amour, de l’amour pour l’homme, pour tous les hommes, même pour les voleurs, même pour les assassins et les bourreaux, ceux qui agissent dans les ténèbres, prêts à vous traiter en animal de boucherie. »
Ils ont été essentiellement « d’obscurs témoins d’une espérance. »
Bruno Chenu, alors rédacteur en chef du journal La Croix, écrivait le 1er Juin 1996 :
« Le sacrifice des moines de Tibhirine a valeur de message pour l’humanité entière. Non, la barbarie n’est pas fatale. Non, les religions ne sont pas les tisons des nouveaux conflits mondiaux. Oui, le respect de la vie humaine est le fondement de toute vie en société. Oui, le parti de l’amour, du pardon, de la communion, est le seul qui donne un avenir à l’homme. »
Pierre Claverie, quant à lui, écrivait à propos de la mort des moines : « c’est le moment ou jamais de signer ce que nous avons vécu par le don de notre vie, comme le Christ l’a fait. La place des chrétiens est là où l’humanité est brisée. »
Et encore : « Savoir que l’on est exposé à la mort ne permet plus de se payer de mots ou de bonnes intentions. Et d’abord, cela nous interroge sur ce que nous sommes réellement pour les autres. »
Que conclure ?
« Au fond, quelle est la contribution originale de Christian de Chergé à une théologie de la rencontre des religions en gestation ?… Elle part d’une posture eschatologique, fortement marquée par la vie monastique. « Le moine est le témoin des fins dernières de l’espérance. » Sa pensée a un pied dans l’eschatologie accomplie dans la mort et la résurrection du Christ… Pour lui l’eschatologie n’est pas projetée dans un futur lointain qu’il faudrait préparer et faire advenir. Elle est un a-venir dans notre présent.
Au fond, sa théologie de la rencontre des religions est une théologie en devenir, dont le statut même est en devenir, à l’affut des signes qui sont donnés au fur et à mesure de l’histoire et au cœur d’un dialogue suivi, constructif, existentiel et pensé sous le regard de Dieu, comme le lieu même ou l’Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. »
« L’originalité de la pensée de Christian de Chergé tient d’une part à l’enracinement de sa théologie dans une expérience spirituelle forte et d’autre part au contexte culturel et social dans lequel cette théologie s’élabore. »
Et Pierre Claverie, trois jours avant sa mort, écrivait : « La mort des moines, qui étaient des frères et des amis de longue date, nous a meurtris encore une fois, mais a resserré nos liens avec des milliers d’Algériens épris de paix et lassés par la violence. Leur message silencieux a retenti dans des millions de cœurs partout dans le monde. Nous restons par fidélité à ce cri d’amour et de réconciliation. »
Père Bernard JANICOT
Du diocèse d’Oran.
Août 2011

