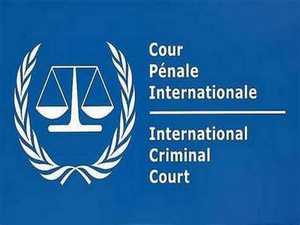Christiane Gillmann apporte ici un éclairage nécessaire sur le respect des droits des Palestiniens et les procédures internationales en cours à Gaza et dans les Territoires occupés par Israël. Juriste et membre du Conseil d’administration de CDM, elle place son travail dans la suite de nos informations sur la situation en Israël-Palestine.
La Cour pénale internationale et la Palestine
On confond de moins en moins la Cour internationale de justice (CIJ) et la Cour pénale internationale (CPI), deux institutions judiciaires internationales qui ont pour trait commun de siéger à La Haye et de s’être penchées sur la Palestine, la première qui a rendu voici 17 ans un avis sur le mur qu’elle a déclaré illégal parce qu’il fait partie du système de la colonisation illégale de la Palestine occupée, la seconde dont la chambre préliminaire a rendu le 4 février de cette année un jugement qui a permis à la procureure d’entamer son enquête sur les crimes de guerre et les vraisemblables crimes contre l’humanité dont sont victimes les Palestiniens vivant en Cisjordanie (dont Jérusalem-Est) et dans la bande de Gaza.
Rappelons cependant brièvement que la Cour internationale de justice est l’organe judiciaire de l’Organisation des Nations unies, créé par sa Charte en 1945, avec pour mission de régler les litiges opposant les Etats qui en sont membres et de donner son avis consultatif aux autres organes de l’ONU (Conseil de sécurité et Assemblée générale) et à certaines de ses agences. Par une résolution de décembre 2003, l’Assemblée générale avait sollicité son avis “sur les conséquences en droit du mur qu’Israël était en train de construire en territoire par lui occupé, notamment à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est”. Aux termes de son avis consultatif du 9 juillet 2004, la CIJ relève d’abord que l’Assemblée générale avait usé de son droit de la saisir, aux lieu et place du Conseil de sécurité qui manquait là à son obligation de maintien de la paix et de la sécurité internationales, du fait de l’obstruction systématique d’un de ses membres permanents ; et l’avis (que l’Assemblée générale a adopté le 24 juillet) relève qu’en construisant le mur en question, Israël viole les dispositions du droit humanitaire de la guerre et du droit international des droits de l’homme, ainsi que le droit à l’autodétermination du peuple palestinien ; qu’il doit immédiatement interrompre cette construction et indemniser les dommages dès à présent causés, les États membres et l’Assemblée générale étant invités à tout mettre en œuvre pour s’en assurer.
Quant à la Cour pénale internationale, elle est une juridiction ayant pour fonction de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d’agression et de crimes de guerre. Elle a été créée par le Statut de Rome, un traité adopté à l’issue d’une rencontre des États membres de l’ONU qui s’est tenue à Rome du 16 juin au 17 juillet 1998. La CPI a pu voir le jour le 1er juillet 2002, après que 60 États aient ratifié leur adhésion au Statut de Rome. Aujourd’hui, sur les 193 Etats membres de l’ONU, sont dans ce cas 132 États (dont tous les États de l’Union européenne) auxquels il faut ajouter la Palestine, membre observateur depuis novembre 2012. 32 États, parmi lesquels deux des plus grands, les États-Unis et la Russie, ont adhéré au Statut de Rome, mais ne l’ont pas ratifié. Parmi les États qui n’ont même pas adopté le Statut de Rome, figurent la Chine, l’Inde et Israël.
La saisine de la CPI par la Palestine
La CPI peut juger les nationaux d’un État ayant ratifié le Statut de Rome, mais aussi des personnes relevant d’un État ne l’ayant pas ratifié, s’ils commettent leurs crimes sur le territoire d’un État l’ayant fait, en l’occurrence la Palestine. Car, sitôt la Palestine admise à l’ONU, même par la petite porte, l’Autorité palestinienne a adhéré aux grands traités internationaux, dont celui de Rome, ce qui lui a permis de déposer plainte à la CPI, début janvier 2015. La CPI est en principe compétente pour juger les auteurs de crimes commis après une telle adhésion ; aussi l’Autorité palestinienne a-t-elle alors demandé – et obtenu – que la compétence de la CPI rétroagisse à juin 2014, ce qui lui permet de connaître des bombardements intensifs, spécialement meurtriers et destructeurs, qu’a subis la bande de Gaza durant tout le mois de juillet 2014.
La plainte de janvier 2015 porte aussi sur les crimes de guerre israéliens que sont les colonies juives installées en Cisjordanie dont Jérusalem-Est, et comme il s’agit là de crimes continus, peu importe la date de construction de telles colonies qui violent l’article 49 de la 4ème Convention de Genève.
La procédure devant la CPI
Au long de l’enquête préliminaire qu’a aussitôt entamée la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, son dossier s’est enrichi de la répression meurtrière de la Marche du retour, cette manifestation hebdomadaire qu’ont entamée les jeunes de la bande de Gaza, fin mars 2018.
La courageuse procureure gambienne a poursuivi son enquête préliminaire, en dépit des multiples menaces qu’elle a dû subir, mais lorsqu’elle l’a clôturée début 2019, elle a préféré se faire cautionner par la chambre préliminaire de la CPI, avant d’ouvrir l’enquête proprement dite ; caution que lui a donnée le jugement du 4 février 2021. De surcroît les électeurs étasuniens avaient entretemps fait le choix de Joseph Biden comme Président des États-Unis, renvoyant ainsi à ses affaires immobilières Donald Trump qui s’en était particulièrement pris à la procureure de la CPI pour avoir osé entamer une enquête préliminaire sur les crimes commis en Afghanistan.
Fatou Bensouda a officiellement ouvert l’enquête le 3 mars, mais c’est son successeur, Karim Khan, un avocat international de nationalité britannique, qui la diligentera, avec l’équipe trouvée sur place et qui connaît bien le dossier. Il affinera notamment le choix des personnes qui devront répondre des trois séries de crimes sur lesquelles porte l’enquête entamée le 3 mars. Il ne pourra s’agir que de citoyens israéliens se trouvant momentanément hors de chez eux, dans des pays signataires du Statut de Rome qui auront de ce fait obligation de les arrêter pour les déférer à la CPI.
Avant de passer la main à Karim Khan, Fatou Bensouda avait fait franchir à l’enquête l’obstacle de la “complémentarité” : la CPI n’est en effet compétente pour juger les crimes internationaux qui lui sont déférés que si l’Etat dont relèvent leurs auteurs ne se charge pas de les poursuivre devant ses propres tribunaux. Fatou Bensouda avait adressé à cet effet, le 9 mars aux autorités israéliennes, une lettre leur donnant un délai d’un mois pour dire si elles envisageaient de telles poursuites. Netanyatou qui était encore Premier ministre et avait affiché son mépris de la CPI et traité son jugement du 4 février d’antisémite, n’a pas répondu dans les temps. De toute manière, la CPI et son procureur n’auraient pas pris au sérieux l’annonce de poursuites nationales contre les colons : la colonisation étant inscrite dans la loi sur l’État-nation du peuple juif de juillet 2018, comme un projet national…
Peu avant l’entrée en fonction du nouveau procureur, deux plaintes ont été déposées à la CPI qui devraient faire l’objet d’une enquête préliminaire avant d’être jointes à l’enquête ouverte le 3 mars.
L’une a été déposée par l’avocat lyonnais Gilles Devers, au nom de Jawad Mahdi, le propriétaire de l’immeuble de la ville de Gaza abritant les bureaux de plusieurs agences de presse – dont Associated Press – qui a été détruit le 15 mai 2021 par un tir de précision. Ce sont deux avocats belges et un avocat jordanien qui ont déposé l’autre plainte, au nom de Mohamed Al Tanini, un habitant de Gaza survivant d’une famille de six personnes, dont quatre enfants, qui a été décimée par le bombardement de leur maison le 15 mai 2021.
L’enquête qui est entrée dans une phase décisive et délicate, pourrait encore durer des mois, voire des années, avant la phase finale que seront la comparution de quelques auteurs de ces crimes devant la Cour pénale internationale et leur jugement. Elle assure au peuple palestinien une sorte de protection, certes symbolique et qui n’a pas dissuadé, ce mois de mai, Benyamin Netanyahou et ses ministres de bombarder une fois de plus la bande de Gaza et de réprimer à balles réelles les manifestations des Palestiniens vivant en Israël comme celles des habitants de la Palestine occupée.
Mais le simple fait qu’elle existe devrait faire réfléchir, peut-être, les membres du nouveau gouvernement israélien, en tout cas une partie de leurs électeurs, et peut-être aussi les dirigeants de tant de pays occidentaux si complaisants avec Israël…
Christiane Gillmann
Avocat honoraire