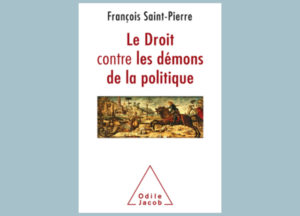Titre
Le droit contre les démons de la politiqueAuteur
François Saint-PierreType
livreEditeur
Paris : Odile Jacob, janvier 2019Nombre de pages
195 p.Prix
22,90 €Date de publication
25 juillet 2019Le droit contre les démons de la politique
En mai-juin 1940, la République française se transforma en quelques mois, passant d’une république parlementaire à un régime autoritaire – l’État français – qui promulgua et appliqua pendant quatre ans une série de mesures contraires aux principes fondamentaux du droit français dont les plus emblématiques furent la promulgation du statut des juifs et l’instauration de juridictions d’exception, les sections spéciales, qui notamment condamnèrent à mort des militants pour des faits pour lesquels ils avaient déjà été jugés à des peines de principe[1]. On sait que cette mutation se réalisa avec la complicité active des institutions de la république déchue et de ses agents, sauf quelques exceptions aussi admirables que rares[2].
Le livre de François Saint-Pierre part de ce désastre et tente de répondre à une question qui préoccupe l’auteur : « Si des circonstances semblables devaient se reproduire, dans un avenir plus ou moins proche, qu’adviendrait-il ? ». L’État de droit qui depuis la Libération s’est lentement construit, notamment sur le fondement des droits de l’homme, serait-il en mesure de résister à un pouvoir qui, même légalement élu, conduirait une politique violant les libertés fondamentales caractéristiques d’une démocratie ?
Il est à peine nécessaire de relever l’actualité d’une telle réflexion quand on considère l’évolution inquiétante des démocraties illibérales.
François Saint Pierre n’est pas le premier venu pour conduire une telle analyse. Brillant avocat pénaliste, il a assuré la défense dans de nombreux procès retentissants et publié plusieurs ouvrages de réflexion sur la stratégie de défense dans le procès pénal moderne[3].
Il a, au surplus, la rare qualité de savoir prendre un peu de hauteur de vue par rapport à son exercice professionnel et, tout en s’en inspirant, de proposer une réflexion sur nos institutions et leur capacité à défendre les libertés publiques, ce qui est assez rare à une époque où droit et justice ne font guère recette dans le débat national.
La question qu’il pose ne peut évidemment trouver de réponse tranchée. François Saint Pierre n’ignore pas que l’Histoire témoigne de la folie qui peut saisir les hommes et les conduire à abattre, en quelques instants, dans la violence, les lentes conquêtes produites par une civilisation qui semblait indestructible. Le livre se conclut d’ailleurs sur la fragilité indépassable de la démocratie.
Mais c’est l’occasion de mener une riche analyse, particulièrement documentée, des mécanismes fondamentaux conçus – essentiellement selon l’auteur, depuis les années 1980 et plus encore au cours de la dernière décennie – pour instaurer en France un État de droit véritable. L’institution judiciaire joue désormais un rôle authentique de régulateur de la loi, en se différenciant notablement du pouvoir politique dont elle constitue un subtil contre-pouvoir[4].
On ne réalise pas toujours la révolution intellectuelle que constitue ce nouvel édifice, dont François Saint-Pierre écrit qu’il ne fut pas construit de manière réfléchie et concertée, mais un peu au hasard d’une série de réformes ponctuelles qui ne furent pas pensées de manière cohérente.
Le premier pilier de cet édifice est constitué par la Cour européenne des droits de l’homme qui est chargée de veiller au respect, par les États, de la Convention européenne des droits de l’homme. François Saint Pierre décrit les multiples avancées issues de sa jurisprudence dont notre droit a bénéficié[5]. A ce propos, il relate l’évolution décisive et originale impulsée par la jurisprudence française. Jusqu’alors la conception institutionnelle française de la justice cantonnait en effet les juges dans une très étroite application de la loi, car selon les principes issus de la Révolution, celle-ci doit toujours avoir la primauté puisqu’elle est censée être l’expression de la volonté du peuple souverain. Il convient donc, selon cette conception, de protéger les citoyens de « l’arbitraire des juges » dans leur application de la loi.
François Saint Pierre considère que cet ordre juridique classique a été radicalement bouleversé lorsque la Cour de cassation a décidé que les juges français seraient dorénavant tenus d’appliquer dans leurs décisions toute la jurisprudence de la Cour européenne[6]. Selon lui, depuis cet arrêt, les juges français, se fondant notamment sur la Convention européenne ont considérablement fait progresser le droit français, « le discours juridique s’est ainsi ouvert au débat public, dans une métamorphose remarquable » et « un droit vivant « s’est substitué à l’ancien système juridique, sans d’ailleurs que le pouvoir politique l’ait anticipé et même, semble-t-il, contre sa volonté.
L’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité[7] forme le second pilier du nouveau droit décrit par François Saint-Pierre. Il explique que dès sa promulgation, les juges ont accueilli plusieurs recours portant sur des questions importantes de libertés publiques, en particulier sur les mesures de garde à vue qui donnaient lieu depuis longtemps à des abus inquiétants.
C’est l’occasion pour François Saint-Pierre de souligner le rôle central que doivent tenir les avocats dans le fonctionnement de ce nouvel État de droit. C’est à eux qu’il incombe d’imaginer les recours qui feront progresser encore notre système vers une meilleure prise en compte des droits et des libertés. « Sans les avocats, les juges redeviennent de simples bouches de la loi, des oblitérateurs de dossiers » proclame-t-il.
Ainsi s’est mis en place, peu à peu, un modèle original d’État de droit, initié par les praticiens- avocats et juges – qui se sont saisis les uns et les autres de nouvelles institutions dont la finalité n’avait pas toujours été complètement mesurée par leurs promoteurs. Si les droits de l’homme y tiennent une place essentielle, on voit bien que c’est, au-delà d’eux, tout un ensemble institutionnel démocratique qui a accouché de cette évolution.
Maître Saint-Pierre ne méconnait pas pour autant les lacunes qui subsistent : l’institution judiciaire reste une énorme machinerie aux mécanismes lents et complexes, écrit-il, qu’on peine à réformer globalement. Il conduit à ce propos une très utile réflexion sur l’évolution du rôle des procureurs de la République qui, dans le nouveau système ont acquis une place déterminante, notamment parce qu’ils détiennent, sans recours réel ni contrôle hiérarchique, le pouvoir d’ouvrir une enquête préliminaire et de la classer sans suite[8].
La route est donc loin d’être achevée, car en réalité, comme le proclamait un des illustres prédécesseurs de Maître Saint-Pierre, « la liberté, comme l’amour, se réinvente chaque jour »[9]
Bernard Ughetto
[1] Violant ainsi un principe fondamental du droit selon lequel on ne peut revenir sur ce qui a été définitivement jugé et a acquis l’autorité de la chose jugée.
[2] Voir notamment dans l’immense bibliographie consacrée à cette question : Jean Moulin : le politique, le rebelle, le résistant / Jean-Pierre Azéma.- Perrin, 2006.- (Tempus, 140) ; Jean Moulin : la République des catacombes. I et II / Daniel Cordier.- Gallimard, 2011.- (Folio. Histoire ; 184 et 185)
[3] Pratique de défense pénale : droit, histoire, stratégie / François Saint-Pierre – Éditions LGDJ, mis à jour tous les ans.
[4] Dans le système constitutionnel français, l’institution judiciaire n’est pas un pouvoir au même titre que le Parlement (pouvoir législatif) ou le Président de la République et son gouvernement (pouvoir exécutif) mais une autorité dont l’indépendance est assurée, selon la Constitution, par le Président de la République.
[5] L’obligation de présenter à un juge, à bref délai, toute personne en état d’arrestation ; l’obligation pour les Cours d’Assises de motiver leurs décisions alors que jusque-là, à la différence des autres juridictions, elles n’étaient pas tenues de donner d’explication formelle sur les raisons de leurs décisions ; la protection des sources des journalistes ; le droit pour les avocats de s’exprimer dans les médias pour la défense de leurs clients ; l’assistance des personnes placées en garde à vue.
[6] Arrêt du 15 avril 2011.
[7] La question prioritaire de constitutionnalité est, selon l’article 61-1 de la Constitution, le droit reconnu à toute personne, qui est partie à un procès ou une instance, de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
[8] Pendant que le juge d’instruction, désormais saisi de plus en plus rarement, a vu son rôle décliner au point qu’on parle périodiquement de le supprimer.
[9] Paul Bouchet. Il fut Bâtonnier du Barreau de Lyon de 1980 à 1981.