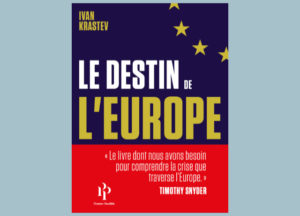Titre
Le destin de l’EuropeSous titre
Une sensation de déjà vuAuteur
Ivan Krastev ; essai traduit de l'anglais par Frédéric JolyType
livreEditeur
Paris : Premier parallèle, 2017Nombre de pages
153 p.Prix
16 €Date de publication
25 mai 2019Le destin de l’Europe. Une sensation de déjà vu
Voilà un petit livre, clair, dense et structuré, qui pourra intéresser, à double titre, quiconque s’interroge sur l’avenir de l’Europe à quelques mois d’élections décisives. D’abord, parce qu’il est écrit par « quelqu’un venu d’ailleurs ». Ivan Krastev est un diplomate bulgare, fondateur du Bureau du Conseil Européen des relations internationales[1], un de ces Européens de l’Est, marqué par l’effondrement brutal du bloc communiste et qui porte un regard original, différent de celui qui a cours dans les pays de l’Ouest ou du Nord. Ensuite, parce que si l’Europe est bordée au sud par la Méditerranée, c’est qu’elle est directement concernée par les migrants qui débarquent sur ses côtes et demandent asile et refuge.
Cette crise migratoire, l’auteur la considère comme « le point focal de son analyse » par son ampleur et les conséquences sur l’état d’esprit des Européens. Dans une première partie : « Nous, les Européens », il passe en revue différentes contradictions comme autant de signaux d’alarme. « Toutes les constructions humaines sont fragiles », écrit-il en évoquant la dislocation de l’Empire austro-hongrois en 1914 et de l’URSS en 1989. C’est le « déjà vu » du sous-titre. Or, « l’Union Européenne a toujours été une idée en quête de réalité ». Depuis le début, on a cherché l’intégration, et jamais envisagé la désintégration (comme le Brexit). L’Europe s’est pensée comme une « fin de l’histoire » : on ne pouvait faire mieux pour construire la paix, protéger les citoyens, encourager le progrès pour tous. Sauf qu’il y a des limites. L’afflux de populations non-européennes, l’absence de politique commune à long terme, le manque de régulations économiques avec pour résultat d’enrichir les riches au détriment des classes inférieures… tout cela entretient le sentiment de ne plus être protégé, d’où l’insécurité et la peur d’un avenir sans perspectives.
C’est alors la remise en cause d’une organisation basée sur l’idée d’universalité, transcendant les particularités nationalistes. La tentation du repli sur « chez soi » s’est accrue avec la mondialisation et la circulation de l’information sur l’internet. Remise en cause aussi des Droits de l’Homme proclamés : ceux qui arrivent n’ont-ils pas les mêmes aspirations que nous ? C’est l’angoisse de devoir partager. L’Europe ne se serait-elle pas piégée toute seule avec ses idéaux ? Et l’auteur constate alors ce qu’il appelle « un clash de solidarité » et un déficit de compassion des anciens pays du bloc de l’Est, comme si l’arrivée des migrants servait de révélateur aux insuffisances de l’Europe. Les plus « anti-migrants » des pays sont ceux qui ont pourtant subi l’oppression de l’ancienne URSS. Quelque trente ans après, ce sont les moins disposés à accueillir des populations qui fuient d’autres oppressions en Méditerranée. D’où l’échec des quotas de répartition. Il existe donc, selon l’auteur, une nouvelle fracture est-ouest en Europe. Les pays de l’Ouest et du Nord ont été des nations établies de longue date, leur universalisme ne venant qu’en second. Les pays de l’Est ont été d’abord écrasés par l’universalisme communiste et aspirent maintenant à être des nations, avec leurs identités propres (cas de la Pologne et de la Hongrie). Pour d’autres, l’image de l’islam colle encore à la domination subie sous l’ancien Empire ottoman (cas de la Roumanie et de la Bulgarie).
À ces considérations géopolitiques, l’auteur ajoute, dans une seconde partie : « Eux, les gens », une autre conséquence de la crise migratoire : le populisme. Les anciens clivages gauche-droite de la politique ont volé en éclats sous l’effet de cette « crise des migrants ». Les idéaux de solidarité, de communauté de destin et d’esprit universaliste n’ont pas résisté aux sentiments d’insécurité et de crainte d’une population vieillissante. D’où, cette généralisation de la critique des élites qui n’assurent plus la protection attendue (attentats, délocalisations…), la critique du système en général auquel « les gens » attribuent tous les maux, et la promotion de solutions simplistes et souvent radicales. Autant de caractéristiques d’un populisme prêt à toutes les manipulations pour désigner le bouc émissaire, c’est-à-dire le migrant. « Ce nouveau populisme, écrit l’auteur, a pour ambition de redonner le pouvoir aux « gens » sans pour autant élaborer le moindre projet commun. Il convient à merveille à des sociétés dont les citoyens sont avant tout des consommateurs qui considèrent leurs gouvernements comme des serveurs de restaurants dont il est attendu qu’ils obtempèrent prestement aux désirs exprimés. » En ce sens, les référendums, prétendument démocratiques, ne font souvent qu’aggraver les clivages.
Depuis sa création, l’Union Européenne a connu bien des crises dans sa construction. Celle des migrants aurait-elle la gravité que veut bien lui donner l’auteur ? Le lecteur conviendra pourtant qu’elle est sérieuse, car elle révèle que les fondements même de l’institution sont ébranlés et fragilisés. Ivan Krastev, Européen convaincu, affirme, selon la célèbre formule, être inspiré par « le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté ». Ses questions qui fâchent, il les propose comme une mise en garde, nécessaire et salutaire, à la veille d’élections importantes pour que l’Europe reste fidèle à elle-même, une Europe capable d’inclure, et non d’exclure.
Claude Popin
[1] Cliquer ICI. Politologue né en 1965 en Bulgarie, Ivan Krastev a créé le Center for liberal strategies, à Sofia, qu’il dirige. Il est également membre permanent de l’Institut pour les sciences humaines de Vienne, en Autriche, où il réside. Ivan Krastev intervient régulièrement dans l’édition internationale du New York Times, mais aussi, en France, dans les pages du Monde. Il est l’un des meilleurs et des plus influents spécialistes du monde post-soviétique et des questions européennes.