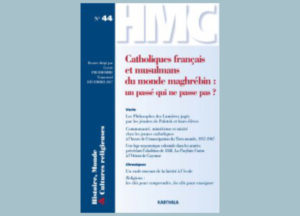Titre
Catholiques français et musulmans du monde maghrébin. Un passé qui ne passe pas ?Sous titre
Dossier de la revue Histoire, Monde & Cultures religieuses, n° 44Auteur
Claude Prudhomme, sous la dir. deType
livreEditeur
Paris : Karthala, 26/09/2018Nombre de pages
160 p.Prix
20 €Date de publication
26 mars 2019Catholiques français et musulmans du monde maghrébin. Un passé qui ne passe pas ?
L’Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la Laïcité (ISERL) publie, depuis 2013, chez Karthala, une revue trimestrielle, HMC (Histoire, Monde & Cultures religieuses), 20 €, dont la livraison (n°44) de décembre 2017, parue en septembre 2018, offre un dossier intitulé : Catholiques français et musulmans du monde maghrébin : un passé qui ne passe pas ? (d’autres articles complètent la revue, qui ne sont pas l’objet de cette recension.[1]
Ce dossier comporte deux parties : l’une historique – en fait centrée sur les années 1910-1960 au Maghreb -, l’autre mettant en relief une pensée minoritaire chez les catholiques mais significative, celle du Père de Foucauld.
Le dossier est complété par une étude fouillée de la notion de da’wa dans le texte coranique et un point de la situation du dialogue interreligieux en 2016… vue par un prêtre chargé de ce dialogue dans l’Église de France.
La richesse du dossier ne peut que faire regretter le petit nombre de chercheurs qui travaillent sur l’histoire des relations entre catholiques et musulmans. Le Maghreb est évidemment un terrain particulièrement intéressant : la Tunisie fut, jadis, un foyer actif du christianisme ; le Maroc a vu des Franciscains tenter une mission par la prédication et la controverse au 13e siècle[2] ; quant à l’Algérie, elle a connu des siècles de « présence » d’esclaves chrétiens dont la conversion à l’islam aurait diminué drastiquement la valeur marchande. Mais, évidemment, le regard historique d’aujourd’hui ne peut qu’insister sur la période de la colonisation, même si -pour les trois pays- elle ne fut pas vécue de la même manière, notamment sur les questions religieuses. Il n’empêche que le catholicisme fut la religion des colons… et ne fut que la religion des colons.
Les articles de Pierre Soumille[3] (sur la Tunisie), de Moussa Marghich[4] (sur le Maroc) et l’entretien avec Oissila Saaidia[5] (qui porte principalement sur l’Algérie) font ressortir l’évidence de la volonté missionnaire des catholiques, de leur prise de conscience des difficultés, voire de l’impossibilité de convertir les « musulmans »… et de leur repli sur le service « gratuit » de la population (éducation, santé). La doctrine Lavigerie[6] est : « pas de conversions individuelles, pas de baptêmes sans l’autorisation des parents, recours à l’évêque pour les adultes qui demandent le baptême ».
Le Père de Foucauld est un homme de son époque, et les articles de Claude Prudhomme[7] et de Pierre Sourisseau[8] montrent à l’évidence que lui aussi se veut missionnaire -et qu’il pense que la conversion des musulmans représenterait un progrès civilisationnel-… mais sa pratique profonde marque une distance avec la doctrine Lavigerie, et peut se résumer en trois mots : responsabilité -je suis responsable de mes frères-, proximité -je dois vivre comme eux- et pauvreté dans cette proximité. Le choix de cette vie avec les pauvres et pour les pauvres, le Père Daniel Moulinet[9] montre qu’elle a une influence indirecte, mais décisive, sur le Concile Vatican II.
Il est difficile de comparer, mais entre la da’wa, disons le témoignage respectueux des libertés que Mohsen Ismaïl discerne dans le Coran, et la persuasion, voire la coercition à laquelle conduit l’interprétation de la da’wa du fiqh[10] aujourd’hui, existe aussi ce sens du respect de l’autre qu’avait le Père de Foucauld.
Il serait facile, en lisant l’ensemble du dossier, de se laisser prendre par le récit des querelles de pouvoir, des contradictions entre l’idéologie laïque et les pratiques, ou entre les revendications d’autonomie par rapport aux gouvernements de l’Eglise (cf. encyclique Maximum illud [11]) et les intérêts d’être financé… mais peut-être serait-il bon d’avoir un regard sur l’histoire longue, et de voir dans la colonisation une étape – ambigüe, certes – de la sécularisation des sociétés. Même aujourd’hui, l’éducation et la santé dans les pays maghrébins ne sont pas « sécularisées » comme le pouvoir français l’avait imposé.
Reste une (petite) déception à la fin de cette lecture. Le Père Vincent Feroldi[12] fait un point extrêmement fouillé de la situation du dialogue islamo-chrétien en France. Mais il manque cruellement l’équivalent pour le Maghreb où, rappelons-le, il n’est pas bon d’être chrétien et Marocain, par exemple, où les questions du mariage interconfessionnel sont criantes. Mais où, cependant, bien des progrès sont en cours et sur lesquels le silence ne fait qu’aggraver le poids d’un passé qui, à mon sens, peut non pas passer, mais être assimilé.
Mgr Michel Dubost
[1] Voir le sommaire du n° 44 sur le site de l’ISERL, en cliquant ICI.
[2] Cf. Franciscains au Maroc : huit siècles de rencontres / Frère Stéphane Delavelle.- Marseille : Publications Chemins de dialogue, mars 2019, dont la recension sera mise en ligne prochainement sur notre site, cliquer ICI.
[3] Pour en savoir plus sur Pierre Soumille (1926-2003), docteur et chercheur en Histoire, cliquer ICI
[4] Pour lire le résumé de la thèse de Moussa Marghich, docteur en Histoire et civilisations (Univ. Paris 8), sur L’Église catholique au Maroc français au temps du Protectorat (1907-1956), cliquer ICI
[5] Oissila Saaidia, agrégée de l’Université en Histoire et Professeur d’histoire contemporaine à l’université Lyon 2, est l’auteur de : L’Algérie catholique, XIXe-XXe siècles.- CNRS éditions, 15/11/2018, cliquer ICI.
[6] Pour en savoir plus sur le cardinal Charles Lavigerie (1825-1892), cliquer ICI.
[7] Claude Prudhomme est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Lumière-Lyon-II. Il s’est spécialisé dans l’histoire de la diffusion du catholicisme par les missions depuis le XIXe siècle : cliquer ICI.
[8] Cliquer sur le livre dont il est l’auteur : Charles de Foucauld (1858-1916) : biographie .-Salvator, 2016. Prix Lyautey 2017.
[9] Daniel Moulinet, professeur à l’Université catholique de Lyon, a écrit 2 livres aux éd. de l’Atelier, intitulés :
Le Concile Vatican II (2002) et Vatican II raconté à ceux qui ne l’ont pas vécu (2012)
[10] Le fiqh est l’interprétation juridique du Coran qui permet d’établir une jurisprudence.
[11]Par sa Lettre Apostolique Maximum illud, du 30/11/1919, le pape Benoît XV (1854 -1922) a voulu donner un nouvel élan à la responsabilité missionnaire d’annoncer l’Evangile. Pour lire la Lettre du pape François à l’occasion du centenaire de la promulgation de Maximum illud, cliquer ICI. Lire aussi La Croix Urbi & Orbi du 25/10/2017 en cliquant ICI.
[12] Vincent Feroldi est directeur du Service national pour les relations avec les musulmans (SNRM) qui est un service de la Conférence des Evêques de France. Pour en savoir plus sur le SNRM, cliquer ICI.