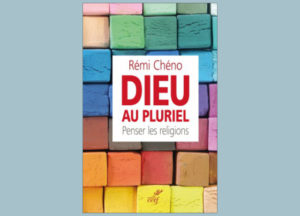Titre
Dieu au plurielSous titre
Penser les religionsAuteur
Rémi ChenoType
livreEditeur
Cerf, février 2017Nombre de pages
155Prix
12 €Date de publication
28 mars 2018Dieu au pluriel
Membre de l’Institut dominicain d’études orientales du Caire (IDEO), Rémi Chéno s’attaque ici à une question difficile : la pluralité des religions, flagrante dans le monde post-moderne qui est le nôtre, conduit-elle inévitablement au relativisme ou, au contraire, à l’affirmation féroce de sa propre identité religieuse, exclusive des autres ? Il est symptomatique, en effet, que notre culture mondialisée voit resurgir des identités religieuses très exclusives, sources de violences récurrentes. Or, c’est le lot de la culture post-moderne, souligne Rémi Chéno, de vivre « aux éclats », c’est-à-dire dans une culture marquée par la diversité des appartenances. Ce qui est vrai au plan de l’art, des goûts, de la sexualité, l’est aussi au plan religieux : « certains dénoncent le supermarché des croyances et le bricolage religieux. Peut-être. Mais quel sens donner à cette confluence au regard de la foi dans le Dieu unique qui intervient dans l’histoire pour sauver tous les hommes » ?
Pour éclairer cette difficile question, l’auteur commence par reprendre la typologie classique quand on aborde le pluralisme religieux. On distingue trois approches principales : l’exclusivisme qui est une forme d’ecclésio-centrisme : ne sont sauvés que ceux qui reçoivent et vivent leur foi au sein d’une Église qui en a reçu le dépôt par son fondateur, le Christ ; l’inclusivisme qui, au contraire, estiment que tout croyant sincère, qu’il connaisse ou non le Christ, est sauvé par lui (c’est le thème du « christianisme anonyme ») ; le pluralisme théocentrique, enfin, consiste à ne plus mettre le christianisme au centre de l’univers des différentes traditions religieuses mais admet que toutes les religions se réfèrent, d’une manière ou d’une autre, au Dieu transcendant (« tous les fleuves mènent à la mer »).
Plutôt que de renvoyer dos à dos ces trois approches, l’auteur essaie de les approfondir en en montrant à la fois les richesses et les limites. De courts chapitres nous introduisent ainsi à la pensée de grands théologiens contemporains, qui, chacun, relève d’une de ces approches : Karl Barth pour l’exclusivisme, Karl Rahner pour l’inclusivisme et John Hick, mais aussi Raimon Panikkar, Michael Amaladoss, Paul Knitter pour le pluralisme.
L’apport de Rémi Chéno est de montrer que « d’autres formes d’une théologie pluraliste sont possibles, qui s’inscrivent dans le courant de pensée post-libérale ». Cette approche estime qu’il est illusoire de s’extraire de sa propre tradition ; il est possible, en revanche, d’accueillir positivement une différence qui dérange. « Les post-libéraux ont conscience d’opérer à leur tour une nouvelle « révolution copernicienne » en renonçant à l’unité pour recevoir positivement la diversité des religions : l’exclusiviste ne conçoit qu’une seule vraie religion (la sienne, bien entendu), l’inclusiviste ne conçoit pas d’autre vérité dans les autres religions que la sienne, en germe chez les autres et accomplie chez lui, tandis que le pluraliste ne trouve la vérité que dans un dénominateur commun à toutes les religions. Dans un retournement « copernicien », les post-libéraux reconnaissent à chaque religion une vérité catégorielle propre, peut-être différente de la leur, voire contradictoire, mais bienvenue ». (p.130).
D’une certaine manière, cette approche permet d’accueillir positivement l’altérité, qui, loin d’être un problème, est peut-être « une énigme voulue par Dieu » (p.132).
Ceux et celles qui ont côtoyé à longueur de vie d’autres croyants comme ceux qui sont interpellés par le voisinage désormais permanent de croyants venant d’autres horizons religieux ne peuvent qu’être intéressés par cet éclairage qui invite à « un dialogue sans confusion » (p.143-148). Il invite à tirer parti de la richesse de nos différences au lieu d’y percevoir d‘abord une menace. On reconnaîtra à cet ouvrage le mérite d’être éclairant, sans être trop simplificateur, sur une question qui reste bien difficile, car elle touche au mystère de Dieu et de la pluralité des chemins humains vers Lui.
Jean-Jacques Pérennès, o.p.
(École biblique et archéologique française de Jérusalem)